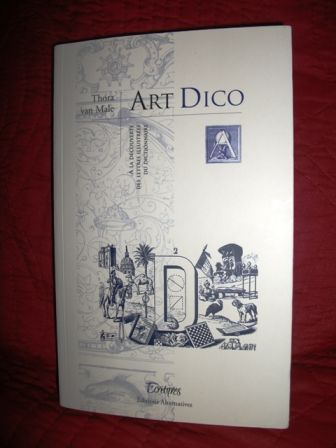Easy Virtue (Un mariage
de rêve), directed by Stephan Eliott. Un monument de délectation perfide.
Avec deux monstres sacrés, Colin Firth, le père, sombre, désabusé, sardonique,
intérieurement détruit par les séquelles morales de la guerre de 14, et Kristin
Scott Thomas, la mère, amère, blessée, tyrannique, fielleuse, dressée dans
l’obsession de perpétuer la propriété familiale, contre vents et marées. Je ne
connaissais pas les deux jeunes gens : Jessica Biel, radieuse,
provocatrice, voluptueuse, et Ben Barnes, charmant et attendrissant, naïf, un
peu désarmé, dans les rôles de Larita et John Whittaker, les jeunes mariés. Ces
deux-là se sont rencontrés au Grand Prix de Monte Carlo, dont Larita aurait été
déclarée vainqueur (- queuse ? –crice ? – queure ? Aargh !)
si elle n’avait pas été une femme. L’accueil fait à l’aventurière dévoyeuse de
fils de famille dans la demeure familiale est glacial, à tous les sens du
terme. Outre madame mère, flanquée de Poppy, sa chihuahua teigneuse, il y a les
deux sœurs de John, (alias Panda^^), Hilda et Marion, toutes deux sérieusement
menacées de devenir vieilles filles. Il y a aussi Sarah, fille du lord et ami
voisin, qui aima John et lui était tacitement promise. Très classe, quant à
elle. Et puis Furber, l’inénarrable ‘butler’.

Le réalisateur est canadien*,
mais le film terriblement anglais. C’est une adaptation récente d’une pièce de
Noël Coward datant de 1924, qu’Hitchcock avait déjà transposée à l’écran en
1928, un film muet.
Dans cette version-ci tout sauf
muette, les dialogues sont éblouissants et il y a aussi beaucoup de musique, dès
le sirupeux générique de début sur fond de soleil couchant dégoulinant. Très
dansante - et très dansée, entre rocks et tango - elle est au petit poil, et
certains des airs sont interprétés par les acteurs eux-mêmes. « Let’s misbehave », «Conduisons-nous mal» ou «Soyons
inconvenants !», telle pourrait bien être la devise de ce film allègrement
– et pourtant mélancoliquement – immoral.
NB : Surtout ne pas regarder la bande-annonce. C'est une vérole, elle contient, comme toujours, les meilleurs moments du film, et surtout ses surprises ! Haro sur les bandes-annonce, qui sont au film ce que sont désormais les quatrièmes de couv' aux livres, pour le plus grand désespoir de l'amateur.
* Non, Australien.
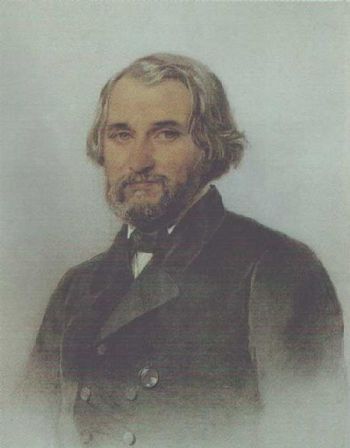


 En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer
En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer 
 La vérité sur la mort de Vera, jeune
yougoslave brûlée vive dans une prétendue histoire de drogue. De cave en bars,
en boîtes, en champs bourbeux, jusqu’à la villa mystérieuse du peintre manchot
Josef Kristi, les deux enquêteurs amateurs remontent la piste de Véra dans ses
liens avec l’histoire récente et meurtrière de la Yougoslavie, la piste serbe. Ils
y rencontrent une suite de douze tableaux en noirs et blancs qui ressuscitent
Vera dans son charme et sa terreur, sous le signe du corbeau, sur un mode
saisissant. On pense à Hitchcock, mais surtout à Poe, et à Manet.
La vérité sur la mort de Vera, jeune
yougoslave brûlée vive dans une prétendue histoire de drogue. De cave en bars,
en boîtes, en champs bourbeux, jusqu’à la villa mystérieuse du peintre manchot
Josef Kristi, les deux enquêteurs amateurs remontent la piste de Véra dans ses
liens avec l’histoire récente et meurtrière de la Yougoslavie, la piste serbe. Ils
y rencontrent une suite de douze tableaux en noirs et blancs qui ressuscitent
Vera dans son charme et sa terreur, sous le signe du corbeau, sur un mode
saisissant. On pense à Hitchcock, mais surtout à Poe, et à Manet.
 Le Docteur Thorne est
le troisième volume des Barchester novels,
après
Le Docteur Thorne est
le troisième volume des Barchester novels,
après