Sobre, intense, éblouissant
Il est entré dans la minuscule salle toute de noir peinte et moquettée. Massif, le crâne rasé, costumé et cravaté de noir. En guise de décor et d’accessoires, une table, une chaise, un verre et une carafe. Les lumières s’éteignent, laissant les premiers rangs éclairés. La voix s’élève, timbrée, grave, puissante et douce : « Qu’est-ce que le monde ? Pourquoi cette vie ? Viendra le jour où tout sera fini. Demain, aujourd’hui peut-être, un homme, quelque part, prononcera le dernier mot prononcé par les hommes sur cette terre. » Le cadre est posé, l’apocalypse n’est pas loin. Un flot intense de paroles – diction parfaite - se déverse, d’autant plus violent que mesuré. Car si parfois l’acteur, Hervé Briaux, pointe sur l’un ou l’autre des spectateurs - crédule sectateur des idées païennes, amateur du plaisir qui corrompt et instille « L’Autre », « Le Corrupteur », dans nos âmes - un index accusateur qui le rive sur son siège, jamais, au fil des cinquante-cinq minutes de spectacle, jamais sa vindicte vengeresse ne s’autorisera d’éclats de voix. Parfois il s’interrompt, s’assied à la table, avale un verre d’eau, laissant la menace se poursuivre dans le silence, et puis il repart, inlassable censeur de tout ce qui, de près ou de loin, peut ressembler à de l’idolâtrie, au premier rang la mimésis théâtrale. Courses, jeux du cirque, pompe des triomphes, tragédies à la grecque – et l’idée de la catharsis est balayée au profit du désastre des passions déchaînées – ou comédies comme écoles de la débauche, sanglants combats de gladiateurs, tous les spectacles sont voués à l’exécration du chrétien qui avec le baptême a renoncé une fois pour toutes à « Satan, sa pompe et ses anges ». Ici, une pincée de mythologie rappelle l’origine abjecte d’Érichtonios fondateur des courses de chars, là une histoire édifiante conte la mort d’une chrétienne corrompue par une représentation théâtrale. La rhétorique est implacable, soulignant les paradoxes ou les erreurs conceptuelles de l’amateur de spectacles.
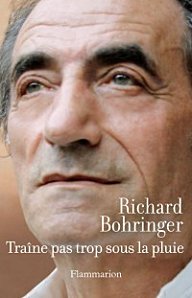 Il a évoqué Rimbaud, mais c’est à Cendrars qu’il m’a fait
aussitôt penser, avec sa diction violente, hachée, précise, sa gouaille et son
lyrisme mêlés, sa passion du monde, des êtres, des excès. En fait d’excès, deux
litres d’eau en quatre petites bouteilles de plastique, telle était la
clepsydre qu’il a désignée en début de… « spectacle d’un seul homme » ?
monologue ? comme étalon de la durée de son spectacle… et il a tenu deux
heures et demie.
Il a évoqué Rimbaud, mais c’est à Cendrars qu’il m’a fait
aussitôt penser, avec sa diction violente, hachée, précise, sa gouaille et son
lyrisme mêlés, sa passion du monde, des êtres, des excès. En fait d’excès, deux
litres d’eau en quatre petites bouteilles de plastique, telle était la
clepsydre qu’il a désignée en début de… « spectacle d’un seul homme » ?
monologue ? comme étalon de la durée de son spectacle… et il a tenu deux
heures et demie. C’est un grand type dégingandé avec les cheveux en pétard, un petit air d’épouvantail à moineaux bonhomme, un accent belge marqué, une diction parfaite. La voix paisible, il arpente une scène presque vide : seulement, côté jardin, une table, deux chaises, et sur la table, une bouteille d’eau minérale, une serviette de
C’est un grand type dégingandé avec les cheveux en pétard, un petit air d’épouvantail à moineaux bonhomme, un accent belge marqué, une diction parfaite. La voix paisible, il arpente une scène presque vide : seulement, côté jardin, une table, deux chaises, et sur la table, une bouteille d’eau minérale, une serviette de Cet aphorisme tient lieu d’épigraphe à
Cet aphorisme tient lieu d’épigraphe à