J'ai rendu tout de suite après lecture Palladium de Boris Razon, extrêmement prisé par les élèves. Les vacances approchant, il fallait que « ça tourne ». Ma lecture date donc déjà d'une bonne quinzaine de jours, et j'ai beaucoup lu depuis. Que l'auteur et mes lecteurs veuillent bien me pardonner mes approximations.
Après lecture, il y a bien des questions que je regrette de ne pas avoir posées à Boris Razon, parce que je n'avais pas lu son roman, ce jeudi-là à Lille, lorsque je l'ai écouté s'entretenir avec les lycéens. Avec Karine Thuil et Thomas Reverdy, et avant la survenue tardive, intempestive et superlativement cavalière de Yann Moix, ils ont beaucoup parlé cuisine littéraire, c'était chaleureux (les trois auteurs s'étaient réciproquement lus) et intéressant. Ainsi Boris Razon a-t-il expliqué qu'il avait, au cours de la longue rédaction de son roman/récit, renoncé à l'usage du présent, pour permettre au lecteur, ce lecteur ami qu'il apostrophe, de rester à distance, pour lui éviter à la fois la posture du voyeur et d'être happé par la terrifiante traversée des apparences qui y est contée. S'y ajoutent le recours, par moments, à l'humour. Et la substitution, dans la version finale du texte, d'un imparfait un peu bancal à un présent trop dévorant. Pourquoi justement cet étrange imparfait ? Parce qu'imparfait? Elle était inconfortable, par instants, à la lecture, cette discordance des temps.... Les phrases sont assez sèches, par sections brèves, le plus souvent entre plus ou moins huit et quatorze syllabes.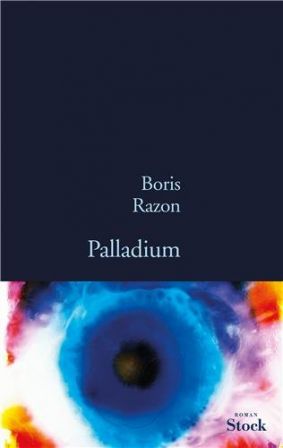 Et
puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman
autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté
une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement
intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient
pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des
récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la
construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de
ce mot de « Palladium »,
au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son
aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre
lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au
centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «
Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine
juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,
avait imaginé par le passé un « Turquish
Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme
si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme
réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et
comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de
la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en
corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et
universel, le mot « roman » se pose
ici de façon à la fois troublante et saisissante.
Et
puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman
autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté
une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement
intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient
pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des
récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la
construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de
ce mot de « Palladium »,
au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son
aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre
lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au
centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «
Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine
juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,
avait imaginé par le passé un « Turquish
Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme
si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme
réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et
comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de
la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en
corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et
universel, le mot « roman » se pose
ici de façon à la fois troublante et saisissante.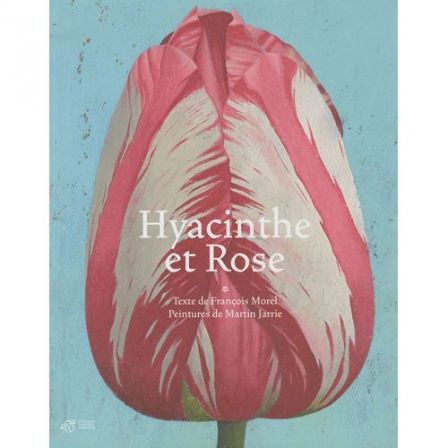 Je n’ai
Je n’ai « Le malgache égrène un cliquetis de mots chantants, un peu comme si vous renversiez
un plein seau de billes de verre dans un escalier de marbre. Il paraît,
quoiqu’il s’agisse peut-être d’une information apocryphe, que cette langue
n’avait jamais été couchée par écrit avant les premiers missionnaires gallois.
Ils avaient embrassé cette tâche avec toute la délectation d’un peuple qui
avait baptisé ses villes et ses villages de noms qui comprennent chacun toutes
les lettres de l’alphabet. La carte du Pays de Galles est en effet parsemée de
noms à se donner des crampes aux maxillaires, comme Llanaelhairarn,
Llanfairfechan, Llanerchymedd, Penrhyndeudraech, sans parler, bien sûr, de
Llafairpwllgwyn-gyllgogerychw-yrindroblantyssiliogogogoch. Aussi ces messieurs
les missionnaires, qui avaient dû se réjouir à la perspective de transformer
une langue entière en un seul tintinnabulement géant, se surpassèrent-ils quant
à la longueur et à la complexité de leur traduction. Dès lors, lorsque mon
dictionnaire s’ouvrit à « buste », et m’informa qu’en malgache, ce
mot se prononçait : ny tra tra seriolana voasokitra hatramin ny tratra no
ho miakatra, je ne fus nullement étonné. Rien, naturellement, ne précisait s’il
s’agissait de la partie supérieure du corps humain, de la poitrine de la femme
ou du portrait sculpté. Mais s’il était question des seins, je me dis qu’il
faudrait un temps fou pour en venir aux autres parties de l’anatomie de celle
que vous courtisez, temps au bout duquel votre conquête en serait sans doute arrivée
à la conclusion que vous faisiez une fixation mammaire et que, par conséquent,
vous n’étiez qu’un jobard. Une langue aussi interminable tend à ralentir le
rythme de la communication, surtout celle de nature sentimentale. »
« Le malgache égrène un cliquetis de mots chantants, un peu comme si vous renversiez
un plein seau de billes de verre dans un escalier de marbre. Il paraît,
quoiqu’il s’agisse peut-être d’une information apocryphe, que cette langue
n’avait jamais été couchée par écrit avant les premiers missionnaires gallois.
Ils avaient embrassé cette tâche avec toute la délectation d’un peuple qui
avait baptisé ses villes et ses villages de noms qui comprennent chacun toutes
les lettres de l’alphabet. La carte du Pays de Galles est en effet parsemée de
noms à se donner des crampes aux maxillaires, comme Llanaelhairarn,
Llanfairfechan, Llanerchymedd, Penrhyndeudraech, sans parler, bien sûr, de
Llafairpwllgwyn-gyllgogerychw-yrindroblantyssiliogogogoch. Aussi ces messieurs
les missionnaires, qui avaient dû se réjouir à la perspective de transformer
une langue entière en un seul tintinnabulement géant, se surpassèrent-ils quant
à la longueur et à la complexité de leur traduction. Dès lors, lorsque mon
dictionnaire s’ouvrit à « buste », et m’informa qu’en malgache, ce
mot se prononçait : ny tra tra seriolana voasokitra hatramin ny tratra no
ho miakatra, je ne fus nullement étonné. Rien, naturellement, ne précisait s’il
s’agissait de la partie supérieure du corps humain, de la poitrine de la femme
ou du portrait sculpté. Mais s’il était question des seins, je me dis qu’il
faudrait un temps fou pour en venir aux autres parties de l’anatomie de celle
que vous courtisez, temps au bout duquel votre conquête en serait sans doute arrivée
à la conclusion que vous faisiez une fixation mammaire et que, par conséquent,
vous n’étiez qu’un jobard. Une langue aussi interminable tend à ralentir le
rythme de la communication, surtout celle de nature sentimentale. »
