Ça y est. Je suis
allée voir Alceste à bicyclette, au
MK2 Bastille, une petite salle avec sortie sur la rue, on ne voit plus ça, en
province... Il y a eu une avalanche de bandes-annonces, telle qu’on en perd
aussitôt le souvenir et le désir de voir les films. Mais pas de pubs. La salle
était modérément occupée, avec à l’ouest des rangées centrales une femme qui,
au cours de la projection, protestait bruyamment à chaque éclat de
rire !!! – C’est une comédie, madame...
Je me suis régalée pendant les 8/10èmes du film.
Les visages et les silhouettes des deux acteurs, puis de l’actrice sont filmés
avec amour, et même le petit rôle de Zoé, la jeune actrice de porno, est
transfiguré par sa lecture, d’abord hésitante, puis affermie, du texte de
Molière.
Mais la jubilation vient du texte. Le Misanthrope, acte I, scène 1, dit, répété, modulé, ressassé,
distillé, sur tous les tons, dans toutes les postures, dedans, dehors, sur fond
de planches bleu délavé ou de vieux murs, de jardin ou de plage, à pied ou à
bicyclette.... une incantation du texte, qui court dans les veines jusqu’à
l’enchantement, celui des comédiens, celui du spectateur. La danse des alexandrins, l’allégresse de la
misanthropie.
Gauthier Valence (Lambert Wilson), à la télévision le docteur Morange
(!) est venu débusquer de sa retraite de l’île de Ré son ami Serge
Tanneur, comédien en rupture de ban, retiré dans la vieille maison léguée par
son oncle, où refoule une fosse septique défaillante. Un misanthrope déjà
retiré en son désert, où pour meubler sa solitude, il peignotte des culs et des
cuisses de femmes en noir et blanc, mi-B.D., mi-croûtes. Mais un furieux de
Molière, imbibé de Jouvet, qui va pousser son alter ego à distiller comme lui
l’alexandrin en des duos toujours plus fluides, plus ardents, plus virtuoses.
C’est une ivresse de Molière, communicative, électrisante, au milieu de
laquelle vient se prendre Francesca, une belle Italienne en rupture de mariage.
L’entrain, la légèreté comique, et surtout une forme de
fraternité par le dire du texte – car le défi est, non seulement que Serge
revienne à la scène, mais que les deux comédiens alternent les deux rôles
principaux comme ils le font à pile ou face à chaque nouvelle répétition – l’entrain
donc, la légèreté et la fraternité vont croissant tandis que se lève sur les paysages
lumineux de l’île un printemps qui libère les corps, les cœurs et les sourires.
C’est pourquoi je suis tellement déçue par la chute du film,
car c’en est une, brutale. Lucchini y reprend le rôle – le cabotinage, avec ce
sourire de requin – non plus d’Alceste, ni même d’un Serge misanthrope, mais de
lui-même. Et sa victoire finale, au désert, sur la plage solitaire, est pour
moi une défaite. Car tout se passe comme s’il dérobait à un Lambert Wilson lui
aussi toujours plus habité, plus animé par le texte, le pouvoir de le
transmettre. Comme si la rupture d’amitié-par-le-texte que cette joute d’egos
devenue duo avait construite, avait coupé au second comédien l’herbe sous le pied.
Ce Serge-Alceste-Fabrice final est fat et mesquin. Il n’est pas blessé, il
blesse. Nulle élégance en lui, nulle fragilité, mais un grincement péremptoire
que soulignent les aigus criards de la voix de Lucchini. Jouvet n’avait pas
joué Alceste par passion du rôle. Lucchini le refuse, se le refuse, nous le refuse par vanité. Il répudie le
théâtre au profit de la vie en ce qu’elle a de plus étriqué, éteint l’émulation
jubilatoire qu’il avait lui-même suscitée. Et l’on se dit que Lambert Wilson,
qui semble souvent gêné aux entournures par la place qui lui est faite - ou non
- dans le film, a donné ici au réalisateur et au comédien et co-scénariste une
sacrée preuve d’amitié et de modestie. Car c’est là que le bât blesse. Si le
film est né d’une idée de Lucchini, Philippe Le Guay n’a pas su in fine y imposer sa
propre marque. Le Misanthrope
quintessencié qu’il avait fait naître, ce film à la gloire d’un théâtre échappé
de la scène pour s’ébrouer sur les routes et le ciel, accompagné par les notes alertes de la chanson de Pierre
Barouh, ce Misanthrope comique au
sens le plus noble du terme s’effondre, réduit au silence, dans le dernier
quart d'heure du film, d’Alceste devenu histrion.




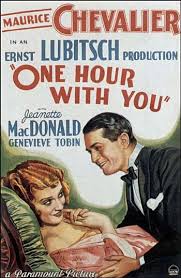

 En quelle année ai-je vu
Judex-de-Franju ? sans doute dans les années 70 ou 72, au ciné club du
Lycée Montgrand, Marseille, dans la « salle de cinéma » aux fauteuils
de bois qui nous servait parfois de salle d’étude. Il m’en était resté un
souvenir vivace de mystère, d’angoisse, de fascination inquiète. J’y ai
repensé, je l’ai écrit, en regardant l’autre jour
En quelle année ai-je vu
Judex-de-Franju ? sans doute dans les années 70 ou 72, au ciné club du
Lycée Montgrand, Marseille, dans la « salle de cinéma » aux fauteuils
de bois qui nous servait parfois de salle d’étude. Il m’en était resté un
souvenir vivace de mystère, d’angoisse, de fascination inquiète. J’y ai
repensé, je l’ai écrit, en regardant l’autre jour 
 Il y a deux
femmes, dans Judex. : Jacqueline
Favraux, la fille du banquier, incarnée dans la blondeur éthérée, aiguë,
émouvante d’Edith Scob. Et Marie Verdier devenue Diana Monti, la méchante,
l’intrigante, la meurtrière et l’amante sulfureuse, incarnée avec génie par la
brune Francine Bergé, magnifique de souplesse, de brutalité et d’autorité, avec
ses yeux de biche intensément soulignés d’eye liner, le très léger strabisme
qui lui confère sa dimension inquiétante, et son corps vigoureux et sinueux, si
érotique dans son maillot noir moulant et ses chaussons d’acrobate, ou dans un
costume d’homme, ou un déguisement ailé de religieuse à la vaste cornette !
Il y a deux
femmes, dans Judex. : Jacqueline
Favraux, la fille du banquier, incarnée dans la blondeur éthérée, aiguë,
émouvante d’Edith Scob. Et Marie Verdier devenue Diana Monti, la méchante,
l’intrigante, la meurtrière et l’amante sulfureuse, incarnée avec génie par la
brune Francine Bergé, magnifique de souplesse, de brutalité et d’autorité, avec
ses yeux de biche intensément soulignés d’eye liner, le très léger strabisme
qui lui confère sa dimension inquiétante, et son corps vigoureux et sinueux, si
érotique dans son maillot noir moulant et ses chaussons d’acrobate, ou dans un
costume d’homme, ou un déguisement ailé de religieuse à la vaste cornette !
 C’est en somme un film de cape et d’épée (« a cloak and dagger story »), qui partagerait la cape et la
dague entre les deux personnages principaux : le poignard fixé sur la
cuisse de Diana-Marie, petite croix étincelante dans le noir de la tenue et
l’obscurité de la nuit, la cape de Judex, le justicier, incarné par Channing
Pollock, un très bel homme au visage impénétrable, imperceptiblement indolent,
avec de vagues airs de Roger Moore sous son large feutre noir. C’était en fait
un magicien professionnel, et il multiplie au cours du film les métamorphoses,
et les apparitions de colombes sorties d’un foulard, en particulier au cours de
la merveilleuse scène du bal des oiseaux, au début du film. Ça aurait un air de
Cocteau, mais beaucoup plus fort, plus resserré, plus suggestif que les féeries
un peu affectées de Cocteau.
C’est en somme un film de cape et d’épée (« a cloak and dagger story »), qui partagerait la cape et la
dague entre les deux personnages principaux : le poignard fixé sur la
cuisse de Diana-Marie, petite croix étincelante dans le noir de la tenue et
l’obscurité de la nuit, la cape de Judex, le justicier, incarné par Channing
Pollock, un très bel homme au visage impénétrable, imperceptiblement indolent,
avec de vagues airs de Roger Moore sous son large feutre noir. C’était en fait
un magicien professionnel, et il multiplie au cours du film les métamorphoses,
et les apparitions de colombes sorties d’un foulard, en particulier au cours de
la merveilleuse scène du bal des oiseaux, au début du film. Ça aurait un air de
Cocteau, mais beaucoup plus fort, plus resserré, plus suggestif que les féeries
un peu affectées de Cocteau.  Irma Vep, anagramme de Vampire. C’est l’héroïne féminine sulfureuse, maléfique, des Vampires de Louis Feuillade, feuilleton cinématographique en dix épisodes aux titres croustillants : L’Homme aux poisons, Le Maître de la foudre, Les Noces sanglantes… Irma Vep, c’est Musidora, presque nue dans son maillot noir moulant dessiné par Paul Poiret - quel dommage qu’il ne lui ait pas associé des ballerines ou chaussons de cirque comme chaussures, parce que ses bottines à talons alourdissent sa silhouette et sa tenue, au demeurant un peu décevante en notre temps de latex et d’élasthane.
Irma Vep, anagramme de Vampire. C’est l’héroïne féminine sulfureuse, maléfique, des Vampires de Louis Feuillade, feuilleton cinématographique en dix épisodes aux titres croustillants : L’Homme aux poisons, Le Maître de la foudre, Les Noces sanglantes… Irma Vep, c’est Musidora, presque nue dans son maillot noir moulant dessiné par Paul Poiret - quel dommage qu’il ne lui ait pas associé des ballerines ou chaussons de cirque comme chaussures, parce que ses bottines à talons alourdissent sa silhouette et sa tenue, au demeurant un peu décevante en notre temps de latex et d’élasthane.
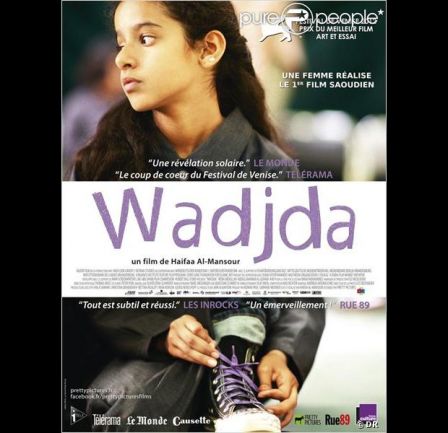


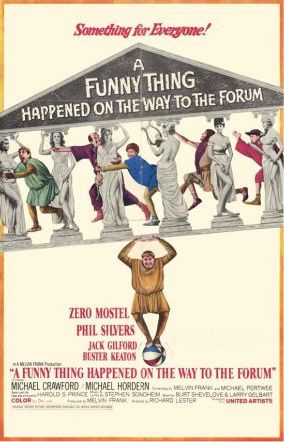 Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des
Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des  Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
 C’est un film bouleversant, qui m’a touchée au cœur de multiples manières. Avant tout, pour la beauté du texte dit sobrement, intensément, par les jolies voix de ces jeunes filles et jeunes gens, dont les visages sont filmés au plus près. Rien n’est déguisé ou gommé des imperfections de l’adolescence, du grain des peaux, et pourtant dès l’ouverture les visages sont éclairés par la ferveur, la justesse avec laquelle sont dits (et non lus, seulement) les mots austères et subtils de madame de La Fayette. Il y a des dizaines et des dizaines d’heures de travail là derrière, pour que les voix sonnent juste, que la diction soit claire, que les accents ne se fassent pas entendre de façon caricaturale, que le texte soit « incarné », - et il l’est, ô combien ! - et je salue la qualité du travail de leur jeune professeur,
C’est un film bouleversant, qui m’a touchée au cœur de multiples manières. Avant tout, pour la beauté du texte dit sobrement, intensément, par les jolies voix de ces jeunes filles et jeunes gens, dont les visages sont filmés au plus près. Rien n’est déguisé ou gommé des imperfections de l’adolescence, du grain des peaux, et pourtant dès l’ouverture les visages sont éclairés par la ferveur, la justesse avec laquelle sont dits (et non lus, seulement) les mots austères et subtils de madame de La Fayette. Il y a des dizaines et des dizaines d’heures de travail là derrière, pour que les voix sonnent juste, que la diction soit claire, que les accents ne se fassent pas entendre de façon caricaturale, que le texte soit « incarné », - et il l’est, ô combien ! - et je salue la qualité du travail de leur jeune professeur, 