On commence à sourire dès les premières images, lorsque Mark, saisi d’une brusque inspiration en regardant les infos, quitte son appart un seau à la main, en quête d’autres seaux – what for ? – et qu’il rive son clou avec esprit et désinvolture au vieux… compère ? - quel est le masculin de commère ? - qui, penché à sa fenêtre, s’en prend à ses mœurs sexuelles. C’est un jour de gay pride, 1984. Et les 20 ans de Joe, le blondinet bien propre sur lui, qui au sortir du métro se trouve enrôlé sans le vouloir comme porteur de banderole. Avec lequel le spectateur se trouve, lui aussi, embarqué dans cette histoire de gays, puisque tel est le terme, décidés à apporter leur soutien à la grève des mineurs de 84-85, sous le « règne » de Thatcher.

Ce film est d’un entrain irrésistible. D’une drôlerie profonde, jamais lourde, toujours spirituelle. C’est une histoire de fraternité humaine sans une ombre de mièvrerie, d’où irradie à chaque image – belle image, paysages et gens sont filmés avec amour – une joyeuse énergie. Les femmes y sont merveilleuses, aussi bien Steph la lesbienne à la crête carotte (« I am the L in LGSM[1] ») que les meneuses du club des mineurs gallois en grève, Siân, Hefina et Gwen. Il y a dans ce film inspiré par des faits bien réels un tel élan de vie que, toute réticence remisée, on rit à pleine gorge (on rit « avec », et non pas contre !), on se laisse parfois submerger par l’émotion, en particulier dans la scène magnifique – bande-son peut-être un poil tonitruante – où la communauté des mineurs en grève chante en chœur « Bread and roses ». La catharsis par le rire joue à plein dans cette comédie au meilleur sens du terme, qui interroge notre rapport au monde, aux autres, à la politique et à la morale, à la sexualité évidemment, sans une once de militantisme. Les femmes galloises ont une telle santé bienveillante, une telle inventivité malicieuse que c’est sans doute cela le plus étrange du film (le plus queer, puisque le film a reçu la Queer Palm à Cannes), le meilleur signe, envers et contre tout, de l’échec de Thatcher, du fait qu’elle n’a – malgré les désastres sociaux qu’elle a engendrés – pas réussi à réduire, à uniformiser ni à asservir les gens.
Pourquoi les Anglais ont-ils un talent si singulier pour les comédies sociales ? Les acteurs – il y a une bonne douzaine de rôles principaux, et sans doute n’est-ce pas étranger à l’énergie communicative du film, cet esprit d’équipe, sans star – sont tous magnifiques. Citons, parce qu’ils sont tout jeunes, Ben Schnetzer, qui incarne Mark avec une présence rayonnante, tout comme Faye Marsay incarne Steph. Et puis le timide Joe, que l’aventure révèle à lui-même. Mais je pourrais aussi bien citer le casting complet, avec ses stars, Bill Nighy ou Dominic West, sans oublier la bande son, qui donne une terrible envie de chanter – et de danser.
Et les seaux, dites-vous ? Pourquoi les seaux ? Courez-y, et vous saurez.
Pride de Matthew Warchus, scénario de Stephen Beresford, musique de Christopher Nightingale (2014).
Une interview du scénariste et du réalisateur ici.
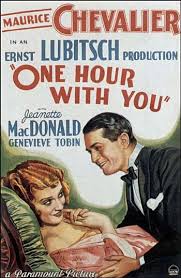


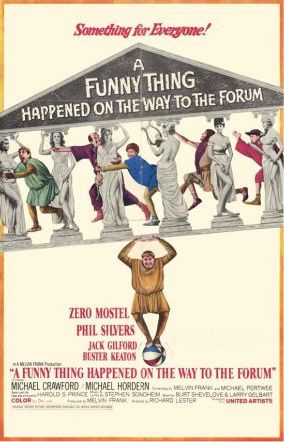 Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des
Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des  Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
