« C’est seulement à l’heure plus paisible du jour qui tombe, quand le soir embaume toutes les peines de cœur, qu’il commença à parler d’une voix douce :
- Je vois une ville profonde à travers les vitres. Elle a un petit air triste. Elle penche ses toits comme on penche la tête. Seul un grand clocher fait le fier, et ses cloches se baladent dans les ruelles. L’heure est grave : c’est l’heure où la ville hésite entre le jour et la nuit. On voit déjà les lumières dans les maisons du centre, plus impatientes du soir, mais la colline s’attarde aux douceurs du jour. Le brouillard se déshabille lentement pour dormir. Il fera beau demain….
Il faisait beau le lendemain, et Franz raconta chaque jour qui suivit. La ville entière entrait par la fenêtre. Quartier par quartier, elle grandissait à travers les vitres.
- Notre hôpital, savez-vous, est chaussé d’un large boulevard, et, de l’autre côté, commence un parc… il est sage comme un jardin de pension un jour de fête, et si bien élevé… »
C’est un malade qui parle, comme on le comprend à la mention de l’hôpital. Ils sont quatre dans la chambre, quatre « allongés », mais il n’y a qu’une fenêtre, et l’occupant du lit qui en est proche a la lourde charge de raconter aux autres le monde vu par la fenêtre. Le premier, Karl, était un taiseux. Franz est le suivant, et le monde qu’il conte est comme enchanté, guidant ses camarades sur la voie de la guérison.
C’est la première nouvelle, La Fenêtre, du recueil Délicieuses Frayeurs, qui en conte onze. C’est magnifiquement écrit, mais j’en ai lu trois, et la chute de chacune était si sombre que j’arrête. J’ai d’ailleurs relu Les Saisons, étrange roman que j’ai déjà évoqué ici à plusieurs reprises.
Eh bien, c’était encore plus
étrange que dans mon souvenir. Il me restait des fragments de scènes, que la
lecture a retissées entre elles.
La Brigde, les Dogde – Walter
et Clara -, la petite Louana et sa cousine Cherline, l’éléphantesque et revêche Mme Ham, le vieil
unijambiste Raurque, Brouette l’ancêtre puant, Berque, Schlitte, Escladoss, et le Croll médecin des hommes et des bêtes,
les sœurs Steppe, Aoste… rauques et hérissés de consonnes ou à peine adoucis
par les hiatus de voyelles, tels sont les habitants du village où Siméon,
fuyant un passé brûlé de soleil et hanté de visions cauchemardesques, est venu
trouver ce qu’il croit être son refuge,
pour y écrire, sur son luxueux « papier drelin » filigrané –
son seul luxe - l’horreur de son esclavage et la mort de sa petite sœur Enina.
Un village anonyme au fond d’une vallée de montagne, au bout du monde. Siméon
le naïf au visage si terriblement ingrat, qui se croit accueilli et célèbre
l’hospitalité de ces villageois plus que frustes - hostiles, instables.


 En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer
En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer 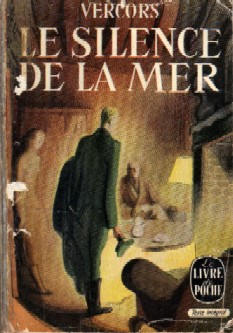
 Roman haï des uns, adoré des autres. Ignorons à tout jamais l’approbation très officielle qu’il a un jour reçue d’un qui ne fraye guère avec les livres - encore moins avec les pavés, échos pour lui d’une époque honnie, celle justement, de la publication de cet énorme volume, par moi découvert huit ans plus tard, et d’emblée adoré. Parce qu'il déborde de toutes parts, parce que c’est un livre-univers, un livre-océan, un livre excessif.
Roman haï des uns, adoré des autres. Ignorons à tout jamais l’approbation très officielle qu’il a un jour reçue d’un qui ne fraye guère avec les livres - encore moins avec les pavés, échos pour lui d’une époque honnie, celle justement, de la publication de cet énorme volume, par moi découvert huit ans plus tard, et d’emblée adoré. Parce qu'il déborde de toutes parts, parce que c’est un livre-univers, un livre-océan, un livre excessif.
