Voilà mon huitième Trollope éclusé : 796 pages, cette fois. Ce sont
Les Diamants Eustace, qui sont bel et bien les très volatils héros du roman, tombés entre les petites mains rapaces de Lady Eustace, née Elizabeth Greystock, Lizzie pour les intimes. Délicate et ravissante orpheline d’un amiral insolvable, sorte d’Emma Bovary à la mémoire farcie de poésie romantique – et Trollope a des accents à la Marcel Aymé dans
Le Confort Intellectuel pour évoquer les brumeuses envolées à la Byron ou à la Shelley – Lizzie a ferré et très vite expédié ad patres son aristocratique premier époux, Sir Florian Eustace, qui, quoique mort désabusé, a légué à sa veuve l’usufruit d’un château écossais avec toutes ses terres, et une coquette rente. Mais lui a-t-il donné ou non une parure de diamants de famille d’une valeur de dix mille livres, et avait-il le droit de le faire ? Le lecteur sait bien, dès le début, puisque
le romancier joue avec lui cartes sur tables, que Lizzie s’est emparé de ces diamants, et que, « biens meubles ou non », elle usera de tous les mensonges pour ne pas les restituer à l’honorable et sourcilleux Mr Camperdown, avoué de la famille Eustace, et très soucieux des intérêts d’icelle.
L’intrigue repose donc à la fois sur une minutieuse étude de cas juridique – la qualité ou non de « biens meubles » des diamants, et les conséquences sur leur éventuelle restitution - et sur une non moins minutieuse étude psychologique : celle des tortueux méandres de l’intelligence, du sentiment, de la morale ? d’une moderne Célimène, en pire. Car en vérité, la jeune Lady Lizzie Eustace est totalement dénuée du moindre sens moral. Habitée par une passion de vivre et de résister à l’adversité qui la submerge, et qui est en elle la seule force authentique, elle ne cesse au fil du roman de mentir, y compris à elle-même, et de réécrire sans cesse, à s’en étourdir, le roman de sa vie. Autour d’elle, de « ses » diamants, de sa rente, gravitent de nombreux personnages, de l’attachante et sincère Lucy Morris à la très cassante – et moustachue - Lady Linlithgowe, en passant par la toute bonne Lady Fawn entourée de ses sept filles à marier, de deux aventurières, Mrs Carbuncle (‘Escarboucle’, variété de pierre précieuse d’un rouge sombre, considérée comme maléfique, mais aussi, en anglais, ‘furoncle’ !!) et sa nièce la hautaine, glaciale Lucinda Roanoke emplie de fureur. Et encore la très huppée lady Glencora Palliser et son cercle, laquelle assure le lien avec le cycle romanesque auquel appartiennent Les Diamants Eustace, les Palliser novels, dont Glencora est l’une des héroïnes (et en vérité j’ai un peu de mal à comprendre dans quel ordre il convient de lire ces romans, le site Trollope n’est pas très clair à ce sujet). Mais surtout, Lizzie est entourée d’une guirlande de soupirants plus ou moins officiels : le maussade Lord Fawn, frère des sept filles à marier, le cousin versatile de Lizzie, Frank Greystock, le ténébreux Lord Georges de Bruce Carruthers – est-il le « Corsaire » dont elle a toujours rêvé ? -, l’éloquent révérend Emilius aux incertaines origines…. Personnages récurrents (on n’en a pas fini avec Lizzie à la fin du roman, quoiqu’elle y ait fait une fin), vaste fresque de la société victorienne, étude scrupuleuse des mécanismes politiques, juridiques, financiers… l’hommage à Balzac devient à chaque lecture plus patent. J’ai d’ailleurs trouvé sur la toile la citation suivante extraite d’une biographie du romancier par John Hall (Oxford 1993) : « Trollope a un jour salué Balzac comme “l’homme qui a inventé le genre de fiction dans lequel j’ai essayé d’inscrire mon oeuvre ” ».
Il y a deux scènes de chasse à courre en Ecosse particulièrement réussies - et Lizzie n’a-telle pas quelque chose du renard que l’on traque ? - des scènes de voyage, d’auberges, de réunions mondaines, de vie familiale, des domestiques, des détectives et des policemen. Et des déclarations d’amour et de rupture verbales ou écrites à foison, de quoi constituer les prémices d’un guide du savoir-dire et écrire dans de telles situations. Il y a, aussi, une réflexion sur la littérature : celle qui égare - les divagations et autres frénésies romantiques dont se repaît Lizzie - celle qui guide et qui oriente, et qu’offre Trollope à son lecteur – sa lectrice – averti (e). Laquelle n’est pas encore lasse de ses quatre mois et quelque 3000 pages avalées, puisqu’elle n’a qu’une envie : lire la suite, à moins que ce ne soit le début ?
Au prochain volume, donc ! dans l’espoir que mon opiniâtre labourage du champ trollopéen fasse des émules…



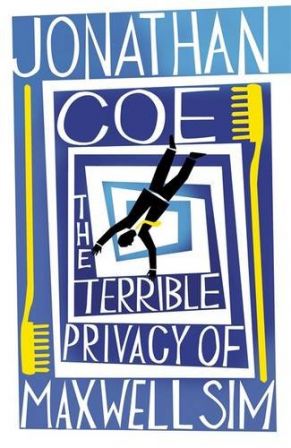
 Le Docteur Thorne est
le troisième volume des Barchester novels,
après
Le Docteur Thorne est
le troisième volume des Barchester novels,
après  Non qu’il soit dans mes habitudes de commenter la littérature dite « jeunesse ». Mais j’ai repris hier soir avant de m’endormir sur l’étagère de ma nièce un des bouquins que j’ai lus et relus dans mon enfance : Daddy-long-legs, de Jean Webster. A l’époque, c’était dans un volume relié de toile avec la silhouette dégingandée du héros éponyme sur la couverture, et le titre en était « Papa Faucheux », car en anglais « daddy-long-legs » est le nom de cette araignée aux immenses pattes fines. Aujourd’hui, on le traduit par « Papa-longues-jambes » et j’aime moins, car on y perd l’araignée. C’est essentiellement un roman épistolaire, à tel point que j’avais oublié que le premier chapitre en était narratif. C’est pourtant dans ce premier chapitre que l’on rencontre Jerusha Abbott, l’aînée des enfants de l’orphelinat John Grier, vêtue de sa robe de guinguan à carreaux. Le
Non qu’il soit dans mes habitudes de commenter la littérature dite « jeunesse ». Mais j’ai repris hier soir avant de m’endormir sur l’étagère de ma nièce un des bouquins que j’ai lus et relus dans mon enfance : Daddy-long-legs, de Jean Webster. A l’époque, c’était dans un volume relié de toile avec la silhouette dégingandée du héros éponyme sur la couverture, et le titre en était « Papa Faucheux », car en anglais « daddy-long-legs » est le nom de cette araignée aux immenses pattes fines. Aujourd’hui, on le traduit par « Papa-longues-jambes » et j’aime moins, car on y perd l’araignée. C’est essentiellement un roman épistolaire, à tel point que j’avais oublié que le premier chapitre en était narratif. C’est pourtant dans ce premier chapitre que l’on rencontre Jerusha Abbott, l’aînée des enfants de l’orphelinat John Grier, vêtue de sa robe de guinguan à carreaux. Le