David van
Reybrouck, Congo, une histoire
Max Gallo, Jésus, l’homme
qui était Dieu
Barthes, Mythologies
Julia Deck, Viviane
Elisabeth Fauville
Les Moissons du futur
de M. Monique Robin
Richard Ford, Une
Saison ardente
Scholastique Mukasonga, Notre-Dame
du Nil
Paul Eluard, Capitale
de la douleur, L’amour, la poésie
Sur une vingtaine de sièges dans ce coin de wagon de seconde, pour une fois très chauffé, ça faisait pas mal de livres et de lecteurs-trices, de tous âges, plongés dans leur lecture, avec ou sans crayon. Quasi seulement des ouvrages à des titres divers d’un intérêt certain... que j’ai lorgnés, parce que je l’ai toujours fait, et que c’est une curiosité d’autrui que je m’autorise. Il y en a dont je suis allée vérifier le titre ou l’auteur sur gogole, à l’arrivée, faute de les connaître, et les voici. Petite « carotte » littéraire prélevée sur un voyage. Mukasonga, c’était moi, et je le chroniquerai lorsque je l’aurai terminé.
Et puis, pour continuer à célébrer les poètes et la poésie :
Ici
Ici, entre les débris des choses et le rien,
nous vivons dans les faubourgs de l’éternité.
Nous jouons parfois aux échecs,
insouciants du destin derrière la porte
nous sommes toujours là,
bâtissant des décombres, des colombiers lunaires.
Nous connaissons le passé sans disparaître
ni passer les nuits d’été
en quête des hauts faits d’un âge d’or.Nous qui sommes qui nous sommes sans nous demander
qui nous sommes car nous sommes toujours là,
ravaudant la robe de l’éternité.
Nous sommes les enfants de l’air chaud et froid,
de l’eau, de la rosée, du feu, de la lumière
et de la terre des pulsions humaines.
Et nous possédons une moitié de vie,
une moitié de mort
des projets d’éternité... et d’identité
Patriotes comme les oliviers, mais nous sommes las de
l’image du narcisse
dans l’eau des chants patriotiques.Sentimentaux involontaires,
lyriques par choix,
nous avons oublié
les paroles des chansons sentimentales.
Ici en compagnie du sens
nous nous sommes révoltés contre la forme
et nous avons modifié l’épilogue.
Dans le nouvel Acte,
nous sommes naturels, ordinaires
et ne confisquons ni dieu
ni les larmes de la victime.
Nous sommes toujours là
et possédons de grands rêves,
comme amener le loup à jouer
de la guitare dans un bal annuel.
Nous possédons aussi de petits rêves,
comme sortir du sommeil
guéris de la déception
et sans rêves impossibles.Nous sommes vivants et présents....
et ce rêve se poursuit.Mahmoud Darwich – Le lanceur de dés et autres poèmes, « Ici. Maintenant. Ici... et maintenant »
Photographies d’Ernest Pignon-Ernest (Actes Sud)
Traduction Elias Sanbar
C’est le poème liminaire. Les photographies de la silhouette grave et pleine d’élan du poète - au milieu d’un chaos de ruines, de pierres, de béton et de métaux arrachés, d’ordures, ou sur un beau mur de pierre tout illuminé de végétation et d’un rayonnant cactus en fleurs, dans l’intimité colorée d’un marché ou dans le mouvement d’une rue - photos prises par E. P-E font au texte un écho grave et recueilli. Seule réserve, le vilain papier trop blanc, trop brillant, trop épais, déplaisant au toucher, qui entrave le plaisir de la lecture. Mais la présence vivante de Mahmoud Darwich est sensible dans ce recueil, résonnant entre sa parole poétique humaniste et combattante et les images du peintre qui lui fait hommage.
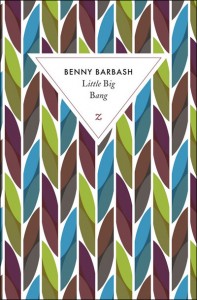 Little Big Bang, de Benny Barbash, est un conte philosophique. Une famille juive ancrée dans la conviction qu’Israël est de toute éternité et en toute propriété la terre ancestrale des Juifs, un père de famille un peu enrobé qui développe à la suite d’un régime l’étrange symptôme d’un olivier poussant dans son oreille (je ne crois pas qu’il soit précisé de laquelle il s’agit), tel en est l’argument. C’est amusant, et grave en même temps. Il y a des tas de scènes très enlevées, et satiriques en diable, entre le grand-père astrophysicien qui met tous les événements individuels en perspective avec l’avenir de la terre – toujours catastrophique voire apocalyptique, mais à des échelles de temps gigantesques -, la grand-mère catégorique et puis le père, la mère et les deux enfants, c’est le fils, Assaf, qui est le narrateur. Il y a aussi l’autre grand-mère, qui a fini par céder aux instances de sa fille et fait des « ateliers Shoah » en famille pour éviter à ses petits-enfants d’être porteurs d’une souffrance innommée. Il y a des scènes très théâtrales, et très enlevées – l’auteur est dramaturge et scénariste -, comme celle-ci :
Little Big Bang, de Benny Barbash, est un conte philosophique. Une famille juive ancrée dans la conviction qu’Israël est de toute éternité et en toute propriété la terre ancestrale des Juifs, un père de famille un peu enrobé qui développe à la suite d’un régime l’étrange symptôme d’un olivier poussant dans son oreille (je ne crois pas qu’il soit précisé de laquelle il s’agit), tel en est l’argument. C’est amusant, et grave en même temps. Il y a des tas de scènes très enlevées, et satiriques en diable, entre le grand-père astrophysicien qui met tous les événements individuels en perspective avec l’avenir de la terre – toujours catastrophique voire apocalyptique, mais à des échelles de temps gigantesques -, la grand-mère catégorique et puis le père, la mère et les deux enfants, c’est le fils, Assaf, qui est le narrateur. Il y a aussi l’autre grand-mère, qui a fini par céder aux instances de sa fille et fait des « ateliers Shoah » en famille pour éviter à ses petits-enfants d’être porteurs d’une souffrance innommée. Il y a des scènes très théâtrales, et très enlevées – l’auteur est dramaturge et scénariste -, comme celle-ci : Mais de QUOI parles-tu ? - de « My First
Sony », de Benny Barbash, 1994, traduit de l’hébreu, très bien, par
Dominique Rotermund, et publié chez Zulma (encore!) en 2008.
Mais de QUOI parles-tu ? - de « My First
Sony », de Benny Barbash, 1994, traduit de l’hébreu, très bien, par
Dominique Rotermund, et publié chez Zulma (encore!) en 2008.