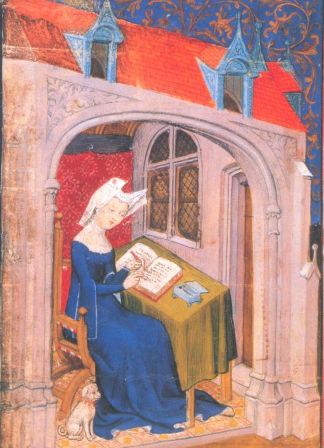« La
guerre se finissait. Ce n'était pas l'heure des bilans, mais l'heure
terrible du présent où l'on constate l'étendue des dégâts. À la
manière de ces hommes qui étaient restés courbés pendant quatre
ans sous la mitraille et qui, au sens propre du terme, ne s'en
relèveraient plus et marcheraient leur existence entière avec ce
poids invisible sur les épaules, Albert sentait que quelque chose,
il en était certain, ne reviendrait jamais : la sérénité. Depuis
plusieurs mois, depuis la première blessure dans la Somme, depuis
les interminables nuits où, brancardier, il allait, noué par la
crainte d'une balle perdue, chercher les blessés sur le champ de
bataille et plus encore depuis qu'il était revenu d'entre les morts,
il savait qu'une peur indéfinissable, vibrante, palpable, était peu
à peu venue l'habiter. À quoi s'ajoutaient les effets dévastateurs
de son ensevelissement; quelque chose de lui était encore sous la
terre, son corps était remonté à la surface, mais une partie de
son cerveau, prisonnière et terrifiée, était demeurée en dessous,
emmurée. Cette expérience était marquée dans sa chair, dans ses
gestes, dans ses regards. […] Il restait sur le qui-vive, tout
était l'objet de sa méfiance. Il le savait, c'était parti pour la
vie entière. Il devrait maintenant vivre avec cette inquiétude
animale, à la manière d'un homme qui se surprend à être jaloux
et qui comprend qu'il devra dorénavant composer avec cette maladie
nouvelle. Cette découverte l'attrista énormément. »
« …
Albert tomba, presque aussitôt après avoir ouvert le sac en
toile d'Édouard, sur un carnet à la couverture rigide fermé par un
élastique, qui avait visiblement bourlingué et qui ne comportait
que des des dessins au crayon bleu. Albert s'assit là, bêtement, en
tailleur, face à l'armoire qui grinçait, immédiatement hypnotisé
par ces scènes, certaines rapidement crayonnées, d'autres
travaillées, avec des ombres profondes faites de hachures serrées
comme une mauvaise pluie; tous ces dessins, une centaine, avaient été
réalisées ici, sur le front, dans les tranchées, et montraient
toutes sortes de moments quotidiens, des soldats écrivant leur
courrier, allumant leur pipe, riant à une blague, prêts pour
l'assaut, mangeant, buvant, des choses comme ça. Un trait lancé à
la va-vite devenait le profil harassé d'un jeune soldat, trois
lignes et c'était un visage exténué, aux yeux hagards, ça vous
arrachait le ventre. Presque rien, à la volée, comme en passant, le
moindre coup de crayon saisissait l'essentiel, la peur et la misère,
l'attente, le découragement, l'épuisement, ce carnet, on aurait dit
le manifeste de la fatalité.
En
le feuilletant, Albert en eut le cœur serré. Parce que, dans tout
cela, jamais un mort. Jamais un blessé. Pas un seul cadavre. Que des
vivants. C'était plus terrible encore parce que toutes ces images
hurlaient la même chose : ces hommes vont mourir. »
Je
suis entrée dans la lecture d'Au Revoir là-haut avec une
sorte de gratitude. Ce sentiment de familiarité que l'on éprouve
en se glissant dans un vieux jean confortable - et qu'on ne s'y
trompe pas, il n'y a dans cette image rien de dépréciatif, et cela
ne signifie nullement que le roman de Pierre Lemaître ne soit pas
inventif, si la forme en est assez classique. D'un classicisme qui
doit beaucoup au XXe siècle d'ailleurs, dès les premiers mots j'ai
senti passer le rythme familier des premiers romans d'Aragon, ces
phrases où un narrateur « impliqué » mêle sa propre
voix adressée aux lecteurs avec celles de ses personnages, dans une
langue très élaborée où s'entrelacent argotismes, syntaxe rompue
et un style beaucoup plus littéraire, très imagé, à la syntaxe
sinueuse et complexe. L'hommage à Aragon est explicite, en fin de
roman, dans l'apostille de remerciements devenue désormais presque
inévitable.
J'ai eu l'occasion d'en parler avec Pierre Lemaître, ce
fameux jour de la rencontre avec les lycéens du Goncourt, jeudi
dernier, au cinéma Le Métropole de Lille où j'ai perdu mon
appareil photo - et cela me serre le cœur car c'est Pierre qui me
l'avait offert. Adoncques, un type charmant, ce Pierre Lemaître,
narquois et disert, heureux de rencontrer un écho chez de jeunes
lecteurs. Il revendique l'héritage aragonien, dès la genèse de son
roman, issu dit-il de la préface d'Aurélien,
cette histoire de type qui ne trouve pas sa place dans la société
de l'après-guerre, dans la vie même de l'après-guerre. Il a cité
aussi, le chapitre consacré à l'attente des soldats démobilisés
comme quasi exercice d'admiration adressé aux Voyageurs de
l'Impériale, que je n'ai pas
lu d'ailleurs, j'y songe.
On
a beaucoup entendu Pierre Lemaître sur les ondes, et sans doute
l'a-t-on vu aussi à la télé, en cette période de
pré-commémoration de la Grande Guerre, aussi ne vais-je pas revenir
en détail sur l'intrigue du roman. Ces deux poilus attelés l'un à
l'autre par la scène infernale qui a signé leur destin de
« hors-la-vie », le 2 novembre 1918, c'est si stupide
d'être victime de la toute fin d'une guerre !... il y a Édouard, le
fils de famille, le rebelle à tous crins, le dessinateur génial,
détruit dans son être le plus intime et le plus manifeste à la
fois par l'accès de générosité quasi incontrôlée qui le saisit
en ce fameux 2 novembre, et Albert, le trouillard, avec ses accès de
fureur et de révolte lucide, et sa fidélité opiniâtre. Tandem
boiteux, réuni aussi par la haine de l'affreux
lieutenant-futur-capitaine Aulnay-Pradelle à la gueule de séducteur
et à l'âme de malfrat. Je l'ai haï dès les premières lignes, et
tout le long du roman, avec constance, et bien plus d'énergie que le
timide Albert. Un méchant parfait, plus vrai que nature.
Dans cette
histoire de l'après-guerre acharnée tout ensemble à oublier et à
commémorer, dans ces affaires d'escroqueries qui sont comme du
roman au cœur de la vie-même, tous les personnages sont réussis,
les femmes aussi, fussent-elles à l'arrière-plan : la sœur
d'Édouard, Madeleine, femme libre et déterminée à la lucidité
tranquille, comme Pauline la soubrette et encore la petite Louise de
douze ans avec son visage pointu, liée par un quasi coup-de-foudre à
Édouard. Une question que je n'ai pas pu poser au romancier, parce
que je n'avais pas fini le roman lorsque je l'ai rencontré : va-t-on
la retrouver, Louise, dont il est dit dans l'épilogue qu'elle
« n'eut pas un destin très remarquable, du moins jusqu'à ce
qu'on la retrouve au début des années 40 » ? ce serait bien,
c'est un beau personnage. Et puis il y a encore ce personnage tard
venu de Merlin le puant, le gris, le banni, l'obstiné. Le minable
grandi par son inexpugnable intégrité. Manifestement très cher à
son auteur, hommage au Cripure de Louis Guilloux, dit-il, (encore un
roman que je n'ai pas lu et je me le reproche), et c'est sur lui,
bêchant les plates-bandes d'un cimetière militaire que se clôt ce
roman, vie et mort, honneur et dérision entremêlés.




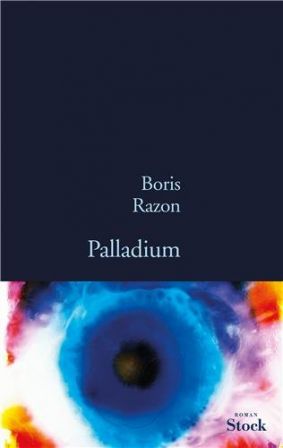 Et
puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman
autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté
une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement
intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient
pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des
récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la
construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de
ce mot de « Palladium »,
au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son
aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre
lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au
centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «
Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine
juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,
avait imaginé par le passé un « Turquish
Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme
si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme
réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et
comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de
la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en
corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et
universel, le mot « roman » se pose
ici de façon à la fois troublante et saisissante.
Et
puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman
autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté
une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement
intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient
pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des
récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la
construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de
ce mot de « Palladium »,
au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son
aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre
lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au
centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «
Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine
juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,
avait imaginé par le passé un « Turquish
Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme
si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme
réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et
comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de
la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en
corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et
universel, le mot « roman » se pose
ici de façon à la fois troublante et saisissante.





 L’un naissait au moment où
l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,
« illuminée ».
L’un naissait au moment où
l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,
« illuminée ».



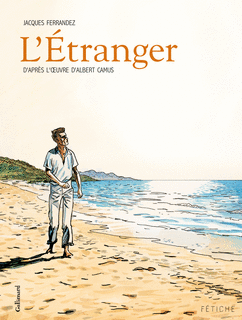 L’Étranger de Camus dans la version graphique de
L’Étranger de Camus dans la version graphique de