Il y a eu aussi des lectures, Goncourt des Lycéens oblige, même si je n'en suis pas partie prenante - plutôt spectatrice, ou compagne. Il est si plaisant de voir les élèves dévorer quelques pavés, se les échanger, et en débattre avec âpreté, ou s'interroger, perplexes. J'ai donc, après La Claire Fontaine lu successivement Le Quatrième mur de Sorj Chalandon, L'Échange des Princesses de Chantal Thomas, et Au Revoir là-haut de Pierre Lemaître.
Et puis il y a eu, jeudi, la rencontre organisée dans le cadre du prix par la FNAC et l'association rennaise Bruit de Lire, à Lille, avec neuf ! des auteurs. Deux plateaux, successivement des auteurs liés par un rapport à la grande Histoire (Sorj Chalandon, Pierre Lemaître, Laurent Seksik pour Le cas Eduard Einstein, Frédéric Verger pour Arden, et Jean-Daniel Baltassat pour Le Divan de Staline), puis quatre liés plutôt par un rapport au monde contemporain et/ou à l'intime : Yann Moix pour Naissance, Boris Razon pour Palladium, Thomas B. Reverdy pour Les Evaporés et enfin Karine Tuil pour L’invention de nos vies. Neuf auteurs et quelque 130 jeunes gens entre 14 et 18 ans, venus du nord, de l'est de la France, et pour la première fois, de Bruxelles. Nous y avons passé toute l'après-midi. C'était très excitant, passionnant, passionné, les auteurs y ont parlé tout aussi bien de l'alchimie qui en eux les conduisait à l'écriture, que de pure cuisine romanesque, temps du récit ou apostrophes au lecteur, ou désir vampirique de s'emparer des histoires des autres, et de quelle légitimité peut-on se prévaloir ? Mais baste, ne mettons pas la charrue avant les bœufs – il faudrait bien qu'un jour un linguiste inspiré invente une autre métaphore que celle-ci, si décalée de toute réalité non seulement contemporaine, mais même simplement agricole... et parlons d'abord de mes lectures.


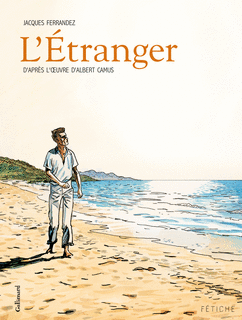 L’Étranger de Camus dans la version graphique de
L’Étranger de Camus dans la version graphique de 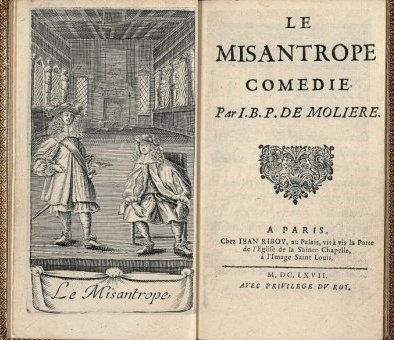
 Rembrandt - Les Pèlerins d'Emmaüs, détail. Paris, Musée du Louvre.
Rembrandt - Les Pèlerins d'Emmaüs, détail. Paris, Musée du Louvre.
 Photo prise sur le site (en lien) du blog de Vincent Josse.
Photo prise sur le site (en lien) du blog de Vincent Josse.


 Les
ballons
Les
ballons 
 Cet aphorisme tient lieu d’épigraphe à
Cet aphorisme tient lieu d’épigraphe à 