On est arrivées au Gaumont Mistral, à Alésia, dix minutes
trop tard pour Alceste à bicyclette.
Alors, pour ne pas repartir bredouilles, et pour rester dans une histoire de
vélo, on est allées voir Wadjda.
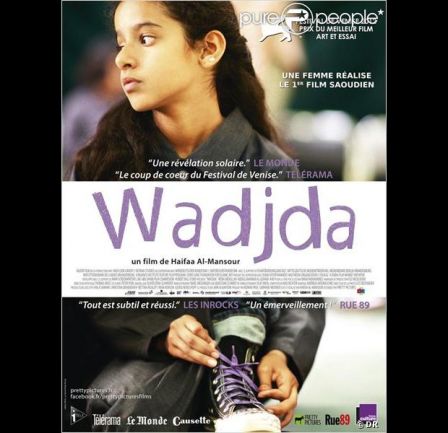
C’est une fillette de dix ans, ensachée comme toutes ses
camarades dans une ignoble robe aussi noire que les blouses d’écoliers
d’autrefois en France, mais sous cette robe, en jeans et chaussée de
‘Converses’ grisâtres. Une petite fille dégingandée, gauche et gracieuse à la
fois, avec ses cheveux longs crêpelés et son grand nez un peu de traviole, ses
yeux vifs. Elle a un copain, Abdallah, tout de blanc vêtu quant à lui, avec sa
petite toque, Abdallah le taquin, qui passant à vélo lui pique son sandwich et
lui arrache son voile. D’où le défi : avoir elle aussi un vélo, pour lui
montrer qu’il ne serait pas si faraud, si elle jouait à armes égales. Qu’elle
saurait le battre, à vélo. Mais les vélos ne sont pas pour les filles, car
c’est à Ryad, Arabie Saoudite, que se déroule l’histoire. Une ville de
poussière et de bâtiments en construction, où dans les rues presque désertes du
quartier de Wadjda passent quelques voitures, le taxi qui transporte en commun
les femmes qui travaillent, des garçonnets en djellaba blanche jouant au foot.
Et puis Wadjda, à pied, courante, sautante, et quelques messieurs d’âge
curieusement bienveillants, comme le marchand de vélos, ce vélo si attirant, si
désirable, avec sa couleur verte et ses franges colorées au guidon. Wadjda
n’est pas très bonne élève, elle est distraite. Mais puisque sa mère refuse de
lui acheter un vélo – ce n’est pas pour les filles, cela risquerait de la
rendre stérile – elle augmente le prix de ses bracelets de laine tressés aux
couleurs des équipes de foot locales, vendus en catimini à ses copines. Et tout
service, désormais, sera monnayé, car si elle n’a pas le goût de l’étude, elle
a indéniablement la bosse du commerce.
Il y a trois lieux essentiels : la maison où Wadjda vit
avec sa mère, une belle femme coquette et sensuelle qui, dès qu’elle doit
quitter la maison – toujours en retard – s’ensevelit dans son
« abaya » noire. Le père, séduisant et affectueux avec sa fille,
n’est pas souvent là. Il y a la rue et les terrains vagues, avec Abdallah et
les boutiques, et puis il y a l’école, sous la coupe de la belle et élégante
Mme Hessa, si sèche, si rigoriste, si intransigeante, qui fait pleuvoir sur la
troupe de ses élèves interdits et punitions, sans pouvoir empêcher les
transgressions, les secrets, les potins. Mais rassembler les 800 riyals
nécessaires à l’achat du vélo n’est pas une mince affaire, et Wadjda se
découragerait presque, lorsque survient l’annonce du concours de récitation
coranique, récompensée d’un prix de 1000 riyals.
C’est un film délicieux. Tous les acteurs y sont excellents,
et il y souffle un vent de vitalité qui fait voler la poussière des interdits
sociaux. On a beau savoir théoriquement comment les choses se passent dans ce
pays où les femmes n’ont ni le doit de conduire, ni celui de se conduire, on ne peut s’empêcher de
bouillir à les voir circuler partout dans la chaleur complètement emballées
dans leurs grandes « tentes » individuelles noires, où il doit faire
une chaleur à crever. A voir marier une camarade de classe de Wadjda, une
gamine. A voir brider tout désir, toute vivacité, toute fantaisie. Et pourtant,
Wadjda va jusqu’au bout de son projet, avec le soutien des siens. C’est une
fable, peut-être, ce n’est pas un film révolutionnaire, sans doute. Mais enfin,
c’est un film tourné avec finesse et talent par une femme dans un pays d’hommes
(le premier paraît-il), un film où l’on voit des femmes se débrouiller avec l’aide des enfants pendant que d’autres
défendent leur fragile et relative liberté par le despotisme et le mensonge, un
film sur les rêves d’affranchissement d’une fillette imaginative qui parvient à
ses fins, un film où même la psalmodie du Coran devient libération d’un rythme
et d’une voix, une merveilleuse histoire de vélo comme accès à l’existence.
La bande-annonce est ici.



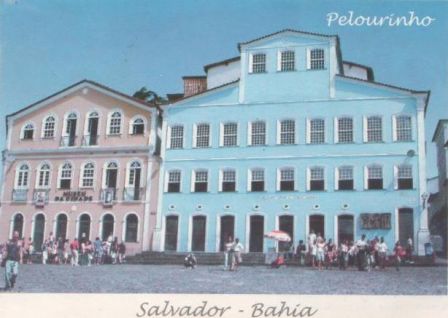

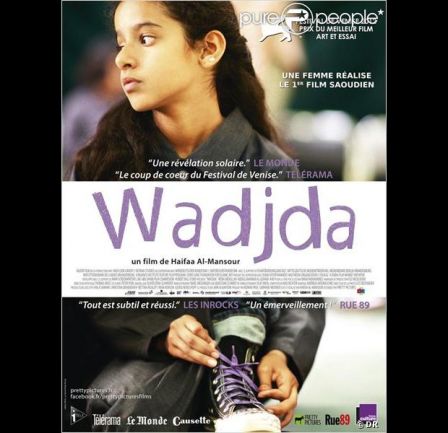



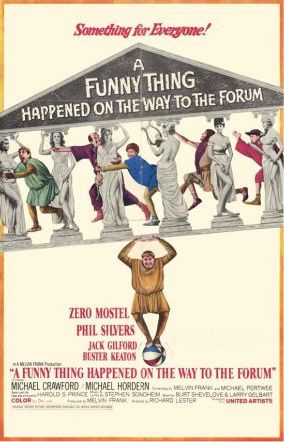 Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des
Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des  Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.
