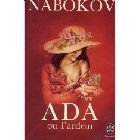mardi, octobre 29 2013
Frédéric Verger - Arden
Par Agnès Orosco le mardi, octobre 29 2013, 13:22
Encore un livre très écrit, très imprégné de Proust, et de Nabokov, qu'évoque d'emblée le titre Arden, pour les lecteurs d'Ada ou l'ardeur, avec son domaine d'Ardis, coupé du monde par une forêt aux airs de conte. Une forêt d'Ardennes (l' « Arden » d'As You Like It) mâtinée d'Ardis. Si l'on fait lisière de cette propension récente au pastiche tous azimuts dans une certaine littérature française – il y a ça aussi dans Il Faut beaucoup aimer les hommes de Darrieussecq, dès le titre, et ça continue comme du Duras, phrases et situations, mais j'ai très vite laissé tomber, à quoi bon, parce qu'alors question niaiserie prétentieuse, ce roman-là mérite le pompon ! -, c'est plein de bonnes idées, Arden, de personnages savoureux et excentriques au premier rang desquels « mon oncle », « Alexandre de Rocoule, rêveur, valseur et fornicateur », Irena son épouse fantomatique et neurasthénique, les maîtres du Grand Hôtel d'Arden. Et puis Salomon Lengyel, acolyte d'Alexandre en composition forcenée d'opérettes (52) toujours inachevées faute de pouvoir s'accorder sur une fin satisfaisante, sa fille la brune et fascinante Esther, et la farandole d'employés de l'hôtel aux airs de personnages d'opérette à moins que ce ne soit le contraire. Arden, forêt du territoire de Marsovie emprunté à La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, dont les librettistes étaient juifs et qui essaya, en vain, de mettre à leur service sa popularité auprès du régime nazi. C'est à peu près ce qui se passe dans la seconde partie du roman – où commence-t-elle ? dans le bloc compact que constituent les 460 pages qui suivent le prologue « autobiographique » du narrateur, 460 pages sans pauses, sans sections, sans même de blancs typographiques, seulement ponctuées çà et là d'insertions telles que récit romancé traduit du yiddish de l'idylle d'Alexandre et d'Irena, ou arguments de nombre d'opérettes : Loth s'amuse, Harry & Cie, Chevalier Fantôme...
Bref, on l'aura compris, Arden est un roman très érudit, bourré de références et de clins d'œil à tous les étages. Une histoire placée sous le signe de la légèreté comme mode de résistance à la plus lourde des oppressions, et un hymne à un art désormais presque oublié alors qu'il était, dans ma jeunesse, si présent sur France Musique, avec par exemple les Concerts-Promenades d'Adolphe Sibert, et qu'il fut si représentatif d'une certaine gaité française, et peut-être même européenne. Pourquoi alors abandonner la lecture d'un ouvrage si allègre dans son propos, son regard sur le monde, sur l'histoire, les livres, la musique ? Eh bien, parce que c'est trop long. Parce qu'il y a trop d'allusions, trop de clins d'œil, trop d'effets et de virtuosité stylistique, architecturale, narrative. Et que le résultat en est, paradoxalement, pénible. Faute, me semble-t-il d'un éditeur exigeant, qui ait su obtenir de son auteur des coupes, que diable !, pour éviter au festin de se transformer en grande bouffe et au feu d'artifice de tourner à l'incendie. Tel qu'il est offert, infligé plutôt, à ses lecteurs, et c'est dommage, Arden est un pavé compact, une bavarde et interminable fantaisie.

 Pense
à demain, c’est presque aussi bien que Splendeurs et Misères des Courtisanes !
Aussi démesuré dans la taille, et dans le projet. 711 pages pour ce dernier
volume d’une trilogie qui aurait pu, à la manière de Zola, s’intituler Les Bertin-Galay,
du nom de la famille racine en quelque sorte, dont au fil des épisodes grouillent
les ramifications. 711 pages grand format, chez Actes Sud, un authentique pavé
(LE pavé de l’été, je n’aurai pas le temps d’en lire un autre, tant pis pour
Marcel devant qui j’ai renâclé, et qui se prête tellement moins bien à la
lecture en train).
Pense
à demain, c’est presque aussi bien que Splendeurs et Misères des Courtisanes !
Aussi démesuré dans la taille, et dans le projet. 711 pages pour ce dernier
volume d’une trilogie qui aurait pu, à la manière de Zola, s’intituler Les Bertin-Galay,
du nom de la famille racine en quelque sorte, dont au fil des épisodes grouillent
les ramifications. 711 pages grand format, chez Actes Sud, un authentique pavé
(LE pavé de l’été, je n’aurai pas le temps d’en lire un autre, tant pis pour
Marcel devant qui j’ai renâclé, et qui se prête tellement moins bien à la
lecture en train). 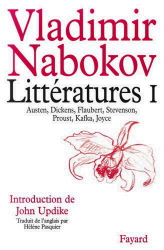 Style and structure are the essence of a book; great ideas are hogwash.
Style and structure are the essence of a book; great ideas are hogwash. En attendant, j’ai la joie et la fierté, car ce travail monumental est l’œuvre d’une vieille et chère amie, d’annoncer ici l’imminente parution (en octobre ?) de la nouvelle édition du Journal de Delacroix, destinée à devenir l’édition de référence, 2512 pages avec l’index, une étude introductive de près de 70 pages, et des dizaines de documents inédits, dont certains retrouvés dans des circonstances très romanesques, à la suite d’enquêtes minutieuses qui n’ont rien à envier au roman policier. Deux volumes dans un boîtier, chez José Corti. Édition de Michele Hannoosh, professeur de littérature française à l’université Ann Arbor du Michigan, qui est pour moi comme une lointaine grande sœur. Je salue ici l’issue d’un projet soutenu avec ferveur, opiniâtreté et quelle acuité ! à travers mille tribulations, et je me réjouis de n’avoir plus pour perspective que de plonger dans cette œuvre qui, par l’univers évoqué, tient de Balzac, et par sa forme, méditée, concertée et pourtant ductile et ondoyante, d’un Montaigne moderne.
En attendant, j’ai la joie et la fierté, car ce travail monumental est l’œuvre d’une vieille et chère amie, d’annoncer ici l’imminente parution (en octobre ?) de la nouvelle édition du Journal de Delacroix, destinée à devenir l’édition de référence, 2512 pages avec l’index, une étude introductive de près de 70 pages, et des dizaines de documents inédits, dont certains retrouvés dans des circonstances très romanesques, à la suite d’enquêtes minutieuses qui n’ont rien à envier au roman policier. Deux volumes dans un boîtier, chez José Corti. Édition de Michele Hannoosh, professeur de littérature française à l’université Ann Arbor du Michigan, qui est pour moi comme une lointaine grande sœur. Je salue ici l’issue d’un projet soutenu avec ferveur, opiniâtreté et quelle acuité ! à travers mille tribulations, et je me réjouis de n’avoir plus pour perspective que de plonger dans cette œuvre qui, par l’univers évoqué, tient de Balzac, et par sa forme, méditée, concertée et pourtant ductile et ondoyante, d’un Montaigne moderne. Roman haï des uns, adoré des autres. Ignorons à tout jamais l’approbation très officielle qu’il a un jour reçue d’un qui ne fraye guère avec les livres - encore moins avec les pavés, échos pour lui d’une époque honnie, celle justement, de la publication de cet énorme volume, par moi découvert huit ans plus tard, et d’emblée adoré. Parce qu'il déborde de toutes parts, parce que c’est un livre-univers, un livre-océan, un livre excessif.
Roman haï des uns, adoré des autres. Ignorons à tout jamais l’approbation très officielle qu’il a un jour reçue d’un qui ne fraye guère avec les livres - encore moins avec les pavés, échos pour lui d’une époque honnie, celle justement, de la publication de cet énorme volume, par moi découvert huit ans plus tard, et d’emblée adoré. Parce qu'il déborde de toutes parts, parce que c’est un livre-univers, un livre-océan, un livre excessif.