Je n’avais croisé Anthony Trollope – Trollope tout court, d’ailleurs
– qu’au détour de La Reine des lectrices , parmi les lectures de la reine. Nom enregistré dans un coin de mémoire, en
attendant. Or samedi, Une Femme fuyant l’annonce,
pavé envisagé comme lecture de vacances, avait déjà été emprunté à la
bibliothèque et j’avais si peu d’idée de ce que je pourrais lire que j’ai
entrepris de me balader dans les rayons, attendant de cueillir, à l’inspiration,
le titre ou le nom d’auteur qui me ferait signe. Tant de titres et tant d’auteurs
dont j’ignore tout ! Et voilà que Trollope. Pourquoi pas ?
Miss Mackenzie,
chez Autrement/Littératures – 2008 – collection bien intéressante et bien
laide, texte imprimé sur du papier recyclé semble-t-il, pas désagréable au
toucher et reposant à l’œil, mais la couverture coupée en deux entre photo d’illustration,
en bas – assez dissuasive même si elle donne une idée du personnage éponyme – la moitié supérieure blanc glacé avec titre, auteur et nature de l’œuvre, et
le petit cartouche rouge vif en haut à gauche, qui jure. Bref, nouvel exemple
de l’inventivité très relative d’une certaine édition française en matière de
jaquette, mais je fais confiance à l’éditeur.
Aussitôt emprunté, aussitôt entamé, avec, très vite, ce sentiment d’allégresse qui me saisit en entrant dans un roman selon mon cœur. Style alerte, situation du contexte familial, social, économique de l’héroïne expédiée avec vivacité pour ne pas ennuyer le lecteur – au prix peut-être de quelque confusion entre les différents Mackenzie, Ball, Johns et Jonathans entre lesquels se joue l’intrigue, mais on les resitue très vite en les voyant surgir, à leur moment. Nombreuses et savoureuses incursions enjouées de l’auteur : adresses au lecteur, clins d’œil amusés, analyses psychologiques, jugements de moraliste… et l’histoire romanesque et charmante d’une vieille fille (36 ans au début du roman), sorte d’Agnès totalement ignorante des us du monde, soudain révélée à la vie à cet âge déjà respectable en touchant un coquet héritage, et par la même occasion, quatre soupirants.
« Margaret Mackenzie avait par la force des choses mené une vie très retirée. Elle n’avait aucune amie à qui elle aurait pu confier ses pensées et ses sentiments. Aucun être vivant, je crois, ne savait qu’il existait dans Arundel Street, dans cette petite chambre qui donnait sur la cour, plusieurs rames de papier où Margaret avait consigné ses pensées et ses sentiments, des poèmes par centaines qui n’avaient rencontré d’autre regard que le sien, des mots d’amour audacieux dans des lettres qu’elle n’avait jamais envoyées, qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’envoyer à personne. De fait, ces lettres commençaient sans destinataire et se terminaient sans signature. (…) Il s’agissait plutôt d’essais, par lesquels elle se prouvait à elle-même de quoi elle serait capable si le hasard voulait bien lui permettre un jour d’aimer. Nul n’avait deviné tout cela, nul n’avait songé à accuser Margaret d’avoir un esprit romanesque.»

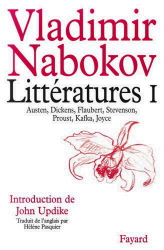 Style and structure are the essence of a book; great ideas are hogwash.
Style and structure are the essence of a book; great ideas are hogwash.