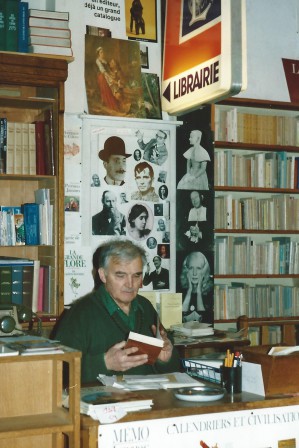Mr Kralik-James Stewart est jeune et irrésistible en vendeur modèle de la maroquinerie Matuschek & Cie, longiligne et super chic avec ses vestons croisés. Il entretient une correspondance avec une inconnue raffinée et romanesque qui comme lui a envie de se cultiver - il cite « Zola’s Mme Bovary », :-) -, et il ne cesse de se chamailler avec Klara Novak, la nouvelle employée, qui méprise le vendeur terre à terre, mesquin et matérialiste qu’elle le soupçonne d’être, alors qu’elle entretient une correspondance avec un inconnu raffiné, cultivé, plein de tact !…. Deux porcs-épics se lardant sans mesure ni précautions de piquants à la moindre conversation. Il y a un employé servile et flagorneur (Vadas), deux demoiselles de magasin (Flora et Ilona) pleines de compassion, le fidèle et bienveillant Pirovitch - avec sa femme, son fils et son bébé, et qui disparaît dès que le patron demande « un avis sincère et honnête » -, Pepi le coursier qui est un vrai Gavroche, un lot soldé de boîtes à cigarettes-boîtes à musique en simili cuir repoussé qui jouent Ochy Tchornya (Les Yeux noirs), des portes qui s’ouvrent, se ferment, qui battent, qui claquent, des conversations sur le coût d’installation d’un ménage, un rendez-vous avec œillet et Anna Karénine (Rendez-Vous est le titre français du film), et Mr Matuschek dont l’humeur se dégrade au fil du film et qui se met à traiter très mal le pauvre Mr Kralik dont la dignité et la loyauté sont mises à rude épreuve.
Dialogues enlevés, très théâtraux, clins d’oeils à la littérature française (Hugo et Corneille sont mis à contribution, l’insatisfaite Mme Matuschek s’appelle Emma) photo magnifique, sentiments subtils et fraternels chez des petites gens menacées par le chômage qui rôde dans les rues de Budapest, rien n’est caricatural. Quant à oser la dernière scène !!! C’est du cinéma absolument revigorant, humaniste jusqu’au bout des ongles, beau, gai, adorable. Merci Lubitsch.