
dimanche, octobre 10 2010
Katharina Hagena - Le Goût des pépins de pomme
Par Agnès Orosco le dimanche, octobre 10 2010, 09:36

dimanche, octobre 10 2010
Par Agnès Orosco le dimanche, octobre 10 2010, 09:36

lundi, avril 19 2010
Par Agnès Orosco le lundi, avril 19 2010, 00:03
Il y avait sur le siège en avant
et à gauche du mien, c’est-à-dire en plein dans mon champ de vision, un type
qui est l’INCARNATION d’une certaine forme de la « beaufitude » et de
l’imbécillité contemporaines. Grand gaillard entre trente et quarante ans, le
cheveu court hérissé en houppette par le gel (qui dira les ravages faits par
Tintin dans la psyché masculine ?), l’œil bleu globuleux et écarquillé. Il
s’est installé – en mini-short, toutes cuisses musclées et poils au vent (en
avril ne te découvre pas d’un fil ?) – il a allumé son ordinateur, et pendant
plus de trois heures, il a joué en cliquant sans trêve à un jeu de golf ! avec
petits personnages enfantins (un ours, un petit chaperon ou plutôt bonnet
rouge, un castor écossais, un cerf nommé Birdie, un renard – « play as the fox
» -), vues panoramiques ou zooms sur un paysage idyllico-lacustro-montagneux
(de plus en plus enneigé au fil de ses échecs, si j’ai bien compris), et succès
ponctués par une sorte de monsieur Muscle en lévitation faisant saillir ses
biceps, sans doute une représentation allégorique de l’ego du joueur. Frénésie
vaine, exhibition de soi, futilité, infantilisme… Au demeurant, écrans à tous
les sièges (dont un nombre considérable était inoccupé, cependant que les gares
grouillent de voyageurs en souffrance, et sans le moindre banc pour s’asseoir),
quelques journaux (''L'Equipe''), peu de livres.
Sans doute était-ce le décor ? l’environnement ? idéal pour découvrir Thomas Bernhardt, qui m’ avait
toujours inspiré une méfiance certaine. « Mes
Prix littéraires ». Une longue suite de perplexités intimes
doublées de fiascos sociaux. C’est qu’il en a eu, Thomas Bernhardt, des prix
littéraires ! un joli pactole. Peu de choses à en dire (la lecture de toute
liste, quand elle n’est pas papoue, a quelque chose de fastidieux), encore que
celle-ci relève quand même d’ « une
forme inédite d’auto-biographie » telle celle qui a été saluée au
cours de la remise, plaisante, joviale, gastronomique, du « Prix de littérature de la Chambre fédérale de
commerce » (sic).
mardi, mars 2 2010
Par Agnès Orosco le mardi, mars 2 2010, 07:00
C’est le veilleur de nuit, qui veille sur le moulin en l’absence de Windisch, qui le dit, et Windisch reprendra le propos, un peu plus tard.
Très brève histoire, constituée de très brefs chapitres dont les titres évoquent… des intertitres de films muets ? Tout comme les personnages, petites gens d’un village de la Roumanie de Ceausescu, ont le rythme mécanique des personnages de ces films. Tous rêvent de partir vers l’Ouest, en Allemagne, puisqu’ils sont pour la plupart d’origine allemande, et tous font ce qu’il faut pour : c’est-à-dire corrompre les fonctionnaires requis, et, en fin de compte, puisqu’il n’y a que cela qui marche, coucher avec le curé et le policier. Comme la femme de Windisch est trop vieille, c’est leur fille Amélie qui y passera.
L’évocation de la nature, omniprésente, inquiétante, magique, avec ses chouettes, la lune sur l’étang, les fleurs desséchées par la chaleur, le pommier dévoreur de pommes, est très picturale, suggestive, musicale. Celle des intérieurs aussi, avec leurs lumières sur la nuit, leurs objets, presqu’animés d’une vie autonome, le coucou, le couteau, l’aiguille, les tableaux, les draps, la vaisselle, une larme de verre à remplir avec de l’eau de pluie. Il y a souvent une intense dimension onirique dans les scènes contées. Mais nature et objets ont en quelque sorte le même degré de vie, d’indépendance, de sens moral ? de liberté même, que les êtres vivants. Il y a dans les personnages quelque chose de machinal qui m’évoque le Wozzeck de Berg. « Densité de la poésie et franchise de la prose », a dit le comité Nobel, qui a accordé le prix de littérature l’an dernier à Herta Müller (Allemande née en Roumanie, émigrée à Berlin, et dont le nom signifie « meunier »). C’est juste. Mais il y a dans cette musique blanche d’un univers où nature, êtres et objets sont quasi dotés du même relief ou écrasés de la même manière, dans le rythme de ces phrases morcelées en éclats, de cet omni-présent qui aplatit tant le passé que l’avenir, une sorte de tragique trivial et neutre qui étouffe. Comme une sécheresse humaine, qui donne envie de s’ébrouer.
C’est chez Maren Sell, en poche.
dimanche, août 30 2009
Par Agnès Orosco le dimanche, août 30 2009, 10:04
Toujours inconfortable, pour moi, la lecture de Stefan Zweig. Ainsi du « Voyage dans le passé » emporté à la plage, et lu d’un trait. Variations sur un poème de Verlaine (Colloque Sentimental, l’ultime et fantomatique poème des « Fêtes Galantes »), nourrie de références à la littérature française – en fait de fantômes, celui du Flaubert de l’ « ''Éducation Sentimentale'' » y est palpable, comme ceux des jeunes ambitieux de Balzac, et sans doute aussi le Julien Sorel de Stendhal – cette nouvelle retrouvée dans les années 90 et récemment publiée en traduction française suivie du texte allemand, rassemble puis sépare l’épouse d’un puissant patron d’industrie, vieux et malade, et l'homme de confiance de celui-ci, un jeune ingénieur ambitieux et tout empreint de rancœur sociale. L’épouse est belle, attentive, pleine de tact. Ludwig (pourquoi avoir traduit le prénom par Louis ?) et elle découvrent à l’annonce de leur séparation (il est envoyé pour une mission de confiance au Mexique) qu’ils sont liés par une passion réciproque. Las ! au lieu des deux ans prévus, ils demeurent neuf ans séparés, la guerre de 14 est passée par là. La nouvelle est le récit avec flashes-back de leurs retrouvailles.
jeudi, août 20 2009
Par Agnès Orosco le jeudi, août 20 2009, 22:42
Le héros de la nouvelle qui suit est Fritz, quatorze ans, que son père pasteur et imprécateur s’est résigné à confier à un oncle et une tante pour qu’il puisse poursuivre ses études dans la petite ville de Résidence. Il rentre au foyer après sa première véritable sortie:
« ... soudain, juste au coin d’une rue, je m’arrêtai devant une grande vitrine, comme frappé par la foudre ; je me sentais décontenancé, sans volonté, tel un animal blessé, mes yeux étaient rivés sur la vitrine. Alors j’oubliai tout, mon paquet, mon entourage, ma commission, moi-même enfin.
Je vais maintenant tenter de décrire tout ce que je vis et je ressentis. Derrière l’immense vitrine tout d’une pièce, polie comme un miroir, étaient assis, ou plutôt semblaient suspendus en l’air, à moins qu’ils ne fussent fichés dans le sol, une ou deux douzaines de corps humains, je veux dire des morceaux de corps humains, sans tête ni jambes, qu’on n’avait pas vraiment abattus, mais plutôt découpés, des troncs pelés ayant gardé leurs hanches, mais sans vie, parfaitement propres, brillants soyeux, extrêmement gracieux et élégants, comme s’ils avaient été déposés là pour être embrassés, baisés. Donc il ne s’agissait pas là d’une boucherie d’êtres vivants, mais… comment dire ?, les hanches étaient parfaitement conservées avec des poitrines rebondies, c’étaient des momies humaines, mais dont on aurait conservé la partie la plus précieuse. Toutes étaient de différentes couleurs, du blanc de neige au noir profond, et ces couleurs n’étaient pas peintes, elles étaient le produit naturel du contenu de ces corps, un contenu qui aurait suinté et se serait solidifié. Les bords, à leur tour, étaient magnifiquement teintés d’une couleur différente. Ce fut surtout un de ces corps à la couleur orangée qui captiva entièrement mes sens. Il avait une bordure noire, des hanches délicates dont une main d’enfant eût presque pu faire le tour à l’endroit le plus étroit ; la poitrine ressortait hardiment, puissamment, le tout donnait une impression de grandeur. C’était là vraiment un être idéal.
« Qui que tu sois, d’où que tu viennes, m’écriai-je intérieurement sous le coup d’une impulsion irrésistible, tu n’en es pas moins splendide, ô créature couleur d’orange ! si je te possédais, rien ne manquerait plus à mon bonheur. »
En parlant ainsi en moi-même, je me penchais le plus possible par-dessus la main de fer qui courait le long de l’immense vitre, maintenant les gens à bonne distance, pour dévorer des yeux mon cher être orangé. Mais en même temps, je repris un peu de sang-froid et je me mis à réfléchir : d’où pouvaient bien provenir ces êtres-troncs ? Existe-t-il quelque part une race humaine aussi précieuse, commençais-je à me demander, une race dont je ne sais encore rien et qu’on m’a tenue jusqu’ici cachée ? Donc une race humaine colorée et brillante, semblable aux espèces que l’on nomme cacadous et colibris chez les oiseaux. Mais pourquoi leur a-t-on coupé la tête et les jambes ? Manifestement parce que les troncs sont ce qu’elles ont de plus beau. Car ce sont bien là des enveloppes humaines. Si elles n’ont pas de plumes comme les oiseaux, elles brillent comme de la soie. Il s’agit des dépouilles d’une race particulière. Ne pourrait-on aller dans leur pays et y vivre heureux ? (…)
Dans la nuit j’eus un rêve : la créature-tronc, baignée d’une lumière orangée, apparut au pied de mon lit , tel un être rayonnant venu de l’au-delà.. Ô poétique apparition ! je me redressai sur ma couche, ne sachant pas si je dormais ou si je veillais encore, et regardai fixement la ravissante image ; sous l’effet d’un désir violent, je m’avançai et tendis les mains (…)
À partir du matin suivant, je fus un autre homme. J’avais maintenant une raison d’être. Mon âme ne vaguait plus à l’aventure ; quand elle était seule, elle savait à quoi se raccrocher ; elle s’évadait vers la petite rue sombre, devant la vitrine luisante et conversait avec la créature orangée, ce tronc fabuleux, qui était peut-être le reste d’une lointaine race de l’Inde. » (…)
Je n’en reproduirai pas plus. J’espère que cet apéritif vous ouvrira l’appétit. C’est extrait de la nouvelle L’Amateur de Corsets, l’une des huit nouvelles que comporte le recueil Un Scandale au Couvent d’Oscar Panizza, publié dans la petite collection Minos aux éditions La Différence.
vendredi, septembre 19 2008
Par Agnès Orosco le vendredi, septembre 19 2008, 21:53
Bon, il va falloir faire quelque chose. Parce que la liste des romans que j’ai lus récemment s’allonge, et que mon Convolvulus déserté se dessèche comme après une attaque de désherbant… même si les conditions ne sont pas propices à l’écriture, allons-y.
Alors, pour commencer avec le sourire, Phébus, encore. L’autre samedi, en quittant le marché, je suis tombée devant la table du libraire, sur Lac-aux-dames de Vicki Baum. Un bouquin dont le titre – et le nom de l’autrice – avaient habité mon adolescence. Je l’ai toujours vu, familier, quelque part dans mon champ de vision, comme j’en entendais toujours avec plaisir les sonorités exotiques. Je savais, aussi, que Colette avait fait les dialogues du film que Marc Allégret en avait tiré. J’ai dû lire ça quelque part dans sa correspondance.
Mais je ne l’avais jamais lu.
Alors, ce samedi-là : jolie couverture, comme souvent, genre dessin de mode et de plage, années 30, et puis surtout, en ouvrant le volume, le sous-titre : « Roman gai d’amour et de disette ». C’est irrésistible !
dimanche, novembre 25 2007
Par Agnès Orosco le dimanche, novembre 25 2007, 23:39
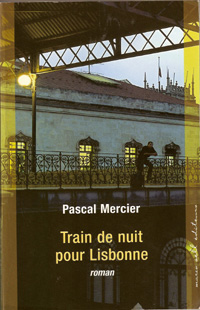
samedi, mai 12 2007
Par Agnès Orosco le samedi, mai 12 2007, 21:33