Pascal Mercier - Train de Nuit pour Lisbonne
Par Agnès Orosco le dimanche, novembre 25 2007, 23:39 - Littérature germanique - Lien permanent
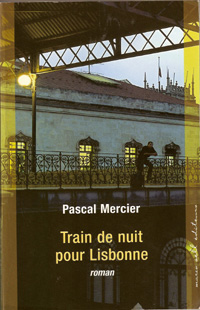
Un matin battu par la pluie, sur le pont Kirchenfeld qu’il traverse chaque jour pour se rendre au lycée où il enseigne depuis trente-sept ans, Raymond Gregorius, savant philologue, lâche brutalement son parapluie, son cartable plein de cahiers d’élèves qui se répandent dans les flaques, et toute la dignité et la discipline d’une vie, pour se précipiter au secours d’une femme en manteau de cuir rouge, au « ''visage d’albâtre'' », au « l''ong serpent de cheveux noirs'' », qui lisait avec fureur et désespoir une lettre qu’elle vient de jeter dans le fleuve, avant de lui inscrire au milieu du front un numéro de téléphone.
Cette scène énigmatique et poignante, très réussie, ouvre le roman de Pascal Mercier Train de nuit pour Lisbonne.
Avec cette femme inconnue, Mundus, puisque tel est le surnom affectueux de celui que les envieux nomment Le Papyrus, rencontre son tardif destin à travers une langue – vivante – qui, brusquement et à tout jamais, pour quelques mots entendus, a enchanté son oreille : le portugais, português. D’un seul élan, Mundus quitte le lycée, en plein cours, abandonnant ses livres et son cartable, et sa vie antérieure. Il découvre le même jour, à la librairie espagnole de Berne, un fascinant petit ouvrage - Amadeu de Prado : Um Ourives das palavras, Un Orfèvre de mots, Lisboa, 1975, aux éditions des Cèdres Rouges. À la merveille de cette langue bruissante et veloutée qui sonne à présent par la voix du libraire, s’ajoute celle d’un texte comme écrit pour lui, et qui le bouleverse.
Plus d’une journée de train, par Genève, Paris et l’Espagne, et Gregorius est à Lisbonne, sur les traces du poète inconnu.
C’est un étrange roman, presque paradoxal dans sa reconstitution rigoureuse d’une cohérence à travers les bribes de lui-même qu’Amadeu de Prado a laissées en tant d’êtres différents, alors qu’il affirme sans cesse la labilité ondoyante et diverse de l’existence et des hommes. Dans la régularité aussi du contrepoint entre le récit de la quête menée par Gregorius et la périodicité cadencée des fragments du recueil de Prado.
Livre construit et déroutant, rigoureux et sinueux à la fois, ce n’est pas un livre que l’on peut laisser et reprendre. Ni un roman dont on puisse parcourir quelques pages avant de s’endormir. L’intrigue en est complexe, les personnages nombreux, et il faut un effort pour s’imprégner, en même temps que Gregorius qui en est littéralement habité, de la prose poétique et philosophique de Prado et des aléas de sa vie. Comme une sorte de mise en abyme psychologique, dont le second tiroir demande exigence et attention.
C’est un roman magique, incantatoire, envoûtant. Magie du récit fait de phrases simples qui – dès le premier paragraphe - digressent en une anecdote qui contredit le portrait initial, phrases sobres et classiques d’où surgissent tout au long du texte surprises, péripéties et personnages, dans la sérénité d’un rythme régulier. Magie du mélange des langues, français (allemand de Suisse dans la VO) et portugais, qui se tressent au fil du recueil de Prado que déchiffre Gregorius, et conduisent le lecteur lui-même à se familiariser avec cette langue latine et exotique à la fois, à y reconnaître du sens. Magie des personnages habités, passionnés, violemment douloureux, que croise et relie Gregorius dans son errance toujours plus familière à travers Lisbonne enivrée de lumière, rencontres fugitives et profondes, ponctués d’objets, de mots, de gestes justes. Magie d’une quête à la fois intérieure et étrangère, et d’un passé pourtant hanté par les sinistres traces de la dictature. Magie des noms - o Estefânia Espinhosa, couronne d’épines… - où résonnent les langues mêlées, grec, latin, portugais… Magie des mots qui habitent Gregorius et peuplent le monde au risque de le faire chanceler si un seul d’entre eux – un hapax de l’Odyssée, chant 22, λιστρον, une pelle à racler le sol – vient à manquer, mots des grands textes, la Bible, Montaigne ou Pessoa, mots familiers de tous les jours, mots d’aujourd’hui et d’autrefois.
Au fil de ses pages, ce roman classique et excentrique se révèle, comme la langue que voulait forger Prado, comparable à un poème, tissé par un orfèvre des mots.
Commentaires
Je me suis laissée prendre par Grégorius, moi aussi... est-ce parce que je suis à la fin d'une page, au début d'une suivante que je ne connais pas encore? mais au fond, toute l'expérience humaine n'est-elle pas constituée de strates... On traverse des moments où on retient son pas, où on se demande ce qui vient ensuite... et aussi ce qui serait arrivé si on avait opté pour un autre chemin... C'est ce pas retenu qui m'a paru fascinant, à moi, en dehors de la belle langue de l'auteur, de la construction intéressante de ce livre, qui laisse une fois la dernière page tournée le loisir d'imaginer, de rêver... Il donne envie d'écrire, de réfléchir... oui, un très beau livre.