Elle est très jolie, la couverture quadrillée du dernier Benny Barbash, chez Zulma, as usual. Alors, je l’ai acheté, parce que j’avais tellement aimé My First Sony, et un peu moins Little Big Bang, plus désincarné. Eh bien, Monsieur Sapiro…. Le livre a beau être cousu, le papier crémeux et doux - plaisirs visuels et tactiles - le personnage central est tellement antipathique que j’ai eu bien du mal à en venir à bout.
Miki (Mickey ?) est dès les premières lignes du roman installé dans le lobby d’un hôtel de luxe (pour moi un lobby était un groupe de pression. J’ai compris à la lecture qu’ici c’était un hall d’accueil), dos au public y installé, et face à un vaste miroir. Il est venu là, un ouvrage sur les mystères de la réfraction en cours de lecture, pour y attendre un hypothétique nouveau tournant de son destin, tournant qu’il saurait, cette fois, saisir, plutôt que de vieillir, amer, auprès de son épouse Liat, directrice de galerie d’art - laquelle a perdu un sein. Et ce sein manquant est pour Miki une source infinie de réflexions, de frustrations, d’impossibilité à passer de l’indifférence hostile à la tendresse. C’est dans le reflet de ce miroir qu’il voit venir vers lui une bien jolie et désirable serveuse armée d’une ardoise, en quête d’un M. Sapiro.
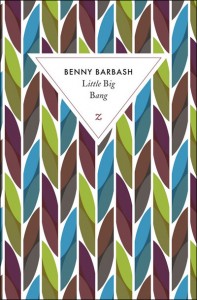 Little Big Bang, de Benny Barbash, est un conte philosophique. Une famille juive ancrée dans la conviction qu’Israël est de toute éternité et en toute propriété la terre ancestrale des Juifs, un père de famille un peu enrobé qui développe à la suite d’un régime l’étrange symptôme d’un olivier poussant dans son oreille (je ne crois pas qu’il soit précisé de laquelle il s’agit), tel en est l’argument. C’est amusant, et grave en même temps. Il y a des tas de scènes très enlevées, et satiriques en diable, entre le grand-père astrophysicien qui met tous les événements individuels en perspective avec l’avenir de la terre – toujours catastrophique voire apocalyptique, mais à des échelles de temps gigantesques -, la grand-mère catégorique et puis le père, la mère et les deux enfants, c’est le fils, Assaf, qui est le narrateur. Il y a aussi l’autre grand-mère, qui a fini par céder aux instances de sa fille et fait des « ateliers Shoah » en famille pour éviter à ses petits-enfants d’être porteurs d’une souffrance innommée. Il y a des scènes très théâtrales, et très enlevées – l’auteur est dramaturge et scénariste -, comme celle-ci :
Little Big Bang, de Benny Barbash, est un conte philosophique. Une famille juive ancrée dans la conviction qu’Israël est de toute éternité et en toute propriété la terre ancestrale des Juifs, un père de famille un peu enrobé qui développe à la suite d’un régime l’étrange symptôme d’un olivier poussant dans son oreille (je ne crois pas qu’il soit précisé de laquelle il s’agit), tel en est l’argument. C’est amusant, et grave en même temps. Il y a des tas de scènes très enlevées, et satiriques en diable, entre le grand-père astrophysicien qui met tous les événements individuels en perspective avec l’avenir de la terre – toujours catastrophique voire apocalyptique, mais à des échelles de temps gigantesques -, la grand-mère catégorique et puis le père, la mère et les deux enfants, c’est le fils, Assaf, qui est le narrateur. Il y a aussi l’autre grand-mère, qui a fini par céder aux instances de sa fille et fait des « ateliers Shoah » en famille pour éviter à ses petits-enfants d’être porteurs d’une souffrance innommée. Il y a des scènes très théâtrales, et très enlevées – l’auteur est dramaturge et scénariste -, comme celle-ci : Mais de QUOI parles-tu ? - de « My First
Sony », de Benny Barbash, 1994, traduit de l’hébreu, très bien, par
Dominique Rotermund, et publié chez Zulma (encore!) en 2008.
Mais de QUOI parles-tu ? - de « My First
Sony », de Benny Barbash, 1994, traduit de l’hébreu, très bien, par
Dominique Rotermund, et publié chez Zulma (encore!) en 2008.