
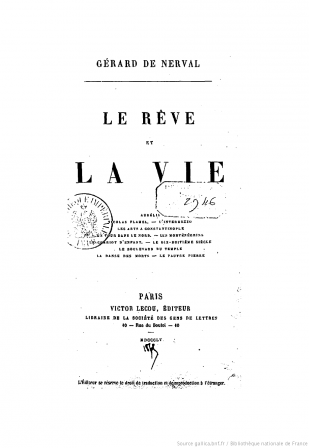
Gérard de Nerval, entre 1854 et 1855. Photographie (détail) d'Adrien Tournachon (Nadar jeune) ©BnF // Le Rêve et la vie est le titre sous lequel Aurélia a paru en volume, en 1855, accompagnée d'autres textes, œuvres et traductions, dont Nicolas Flamel, L'Intermezzo, Les Arts à Constantinople, Une Tour dans le Nord, etc.
UN ASPECT DU ROMANTISME EN GÉNÉRAL ET DU ROMANTISME FRANÇAIS EN PARTICULIER : LA RÉHABILITATION DE LA POÉSIE ORALE (POPULAIRE) PAR LA POÉSIE LETTRÉE (SAVANTE)
«La fille au Roi Louis, dont Nerval disait qu’elle est « un des plus beaux airs qui existent, un chant d’église croisé par un chant de guerre », illustre la légende de la fille amoureuse emprisonnée par son père. Déjà mise en oeuvre par le trouvère Audefroy le Bâtard, cette complainte qui fut chantée sur plus de trente mélodies différentes, se retrouve notamment sous le titre La Belle Isambourg dans un recueil d’airs de cour de 1607. La mélodie enregistrée ici est celle que Nerval collecta dans le Valois et que l’on peut aussi entendre dans Acajou de Favart (1744) sous le titre du Beau Déon ainsi que dans un cantique spirituel de Berton (1754).»
Extrait du livret de Chansons d'autrefois et Chemins de mélancolie, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre, p. 14.
Un ouvrage de référence : Paul Bénichou, Nerval et la chanson folklorique, José Corti, 1970, notamment pages 258-267 et passim.

Extrait de la partition.
On connaît plusieurs versions de cette chanson. Voici le texte qu'en donne Nerval lui-même dans la 7e lettre qui compose la nouvelle «Angélique», publiée en 1850 avant d'être insérée dans Les Filles du Feu en 1854. Tout de suite après, la version proposée par Henri Davenson (texte intégral), dans laquelle vous retrouverez les couplets de la chanson reconstituée par Vincent Dumestre (texte coupé : de la version précédente, il reprend les couplets 1 à 4 puis 10 à 18).
«Quant au caractère des pères de la province que je parcours, il a été éternellement le même si j'en crois les légendes que j'ai entendu chanter dans ma jeunesse. C'est un mélange de rudesse et de bonhomie tout patriarcal. Voici une des chansons que j'ai pu recueillir dans ce vieux pays de l'Ile-de-France, qui, du Parisis, s'étend jusqu'aux confins de la Picardie:
Le roy Loys est sur son pont
Tenant sa fille en son giron.
Elle lui demande un cavalier.
Qui n'a pas vaillant six deniers!
- Oh! oui, mon père, je l'aurai
Malgré ma mère qui m'a portée.
Aussi malgré tous mes parents
Et vous, mon père... que j'aime tant!
- Ma fille, il faut changer d'amour,
Ou vous entrerez dans la tour...
- J'aime mieux rester dans la tour,
Mon père! que de changer d'amour!
- Vite... où sont mes estafiers,
Aussi bien que mes gens de pied ?
Qu'on mène ma fille à la tour,
Elle n'y verra jamais le jour!
Elle y resta sept ans passés
Sans que personne pût la trouver
Au bout de la septième année
Son père vint la visiter.
- Bonjour, ma fille! comme vous en va?
- Ma foi, mon père... ça va bien mal;
J'ai les pieds pourris dans la terre,
Et les cotés mangés des vers.
Ma fille, il faut changer d'amour
Ou vous resterez dans la tour.
- J'aime mieux rester dans la tour,
Mon père, que de changer d'amour! »
Gérard de Nerval, Œuvres complètes, tome III, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1993, pages 493-494.
(La configuration de ce blogue ne me permet pas de restituer la composition strophique du poème)
1.Le roi Louis est sur son pont,
Tenant sa fille en son giron ;
Elle se voudrait bien marier
Au beau Déon, franc chevalier.
2. « Ma fille, n'aimez jamais Déon,
Car c'est un chevalier félon ;
C'est le plus pauvre chevalier
Qui n'a pas vaillant six deniers.
3. — J'aime Déon, je l'aimerai,
J'aime Déon pour sa beauté,
Plus que ma mère et mes parents,
Et vous, mon père, qui m'aimez tant.
4. — Ma fille, il faut changer d'amour,
Ou vous entrerez dans la tour.
— J'aime mieux rester dans la tour,
Mon père, que de changer d'amour.
5. — Et vite, où sont mes estafiers,
Mes geôliers, mes guichetiers,
Qu'on mette ma fille en la tour :
Elle n'y verra jamais le jour. »
6. Elle y fut bien sept ans passés
Sans que personne la pût trouver.
Au bout de la septième année,
Son père vint la visiter :
7. « Bonjour, ma fille, comment vous va ?
— Hélas, mon père, il va bien mal :
J'ai un côté mangé des vers,
Et les deux pieds pourris ès fers.
8. Mon père, avez-vous de l'argent,
Cinq à six sous tant seulement ?
C'est pour donner au geôlier,
Qu'il me desserre un peu les pieds.
9. — Oui-da, ma fille, nous en avons,
Et des mille et des millions :
Nous en avons à vous donner,
Si vos amours voulez changer.
10. — Avant que changer mes amours,
J'aime mieux mourir dans la tour.
— Eh bien ma fille, vous y mourrez,
De guérison point vous n'aurez. »
11. Le beau Déon, passant par là,
Un mot de lettre lui jeta ;
Il y avait dessus écrit :
« Belle, ne le mettez en oubli ;
12. Faites-vous morte ensevelir,
Que l'on vous porte à Saint-Denis ;
En terre, laissez-vous porter,
Point enterrer ne vous lairrai. »
13. La belle n'y a pas manqué,
Dans le moment a trépassé ;
Elle s'est laissé ensevelir,
On l'a portée à Saint-Denis.
14. Le roi va derrière en pleurant,
Les prêtres vont devant chantant :
Quatre-vingts prêtres, trente abbés,
Autant d'évêques couronnés.
15. Le beau Déon passant par là :
« Arrêtez, prêtres, halte-là !
C'est m'amie que vous emportez,
Ah ! laissez-moi la regarder ! »
16. Il tira son couteau d'or fin
Et décousit le drap de lin :
En l'embrassant, fit un soupir,
La belle lui fit un souris :
17. « Ah ! voyez quelle trahison
De ma fille et du beau Déon !
Il les faut pourtant marier,
Et qu'il n'en soit jamais parlé.
18. Sonnez, trompettes et violons,
Ma fille aura le beau Déon.
Fillette qu'a envie d'aimer,
Père ne l'en peut empêcher ! »
19. Quatre ou cinq de ces jeunes abbés
Se mirent à dire, tout haut riant :
« Nous sommes venus pour l'enterrer,
Et nous allons la marier ! »
Henri Davenson, Le Livre des chansons, Club des Libraires de France, 1958, p. 100-103.
(La configuration de ce blogue ne me permet pas de restituer la composition strophique du poème)
Chansons et légendes du Valois
«Chaque fois que ma pensée se reporte aux souvenirs de cette province du Valois, je me rappelle avec ravissement les chants et les récits qui ont bercé mon enfance. La maison de mon oncle était toute pleine de voix mélodieuses, et celles des servantes qui nous avaient suivis à Paris chantaient tout le jour les ballades joyeuses de leur jeunesse, dont malheureusement je ne puis citer les airs. J'en ai donné plus haut quelques fragments. Aujourd'hui, je ne puis arriver à les compléter, car tout cela est profondément oublié ; le secret en est demeuré dans la tombe des aïeules. On publie aujourd'hui les chansons patoises de Bretagne ou d'Aquitaine , mais aucun chant des vieilles provinces où s'est toujours parlé la vraie langue française ne nous sera conservé. C'est qu'on n'a jamais voulu admettre dans les livres des vers composés sans souci de la rime, de la prosodie et de la syntaxe ; la langue du berger, du marinier, du charretier qui passe, est bien la nôtre, à quelques élisions près, avec des tournures douteuses, des mots hasardés, des terminaisons et des liaisons de fantaisie, mais elle porte un cachet d'ignorance qui révolte l'homme du monde, bien plus que ne fait le patois. Pourtant ce langage a ses règles, ou du moins ses habitudes régulières, et il est fâcheux que des couplets tels que ceux de la célèbre romance: Si j'étais hirondelle, soient abandonnés, pour deux ou trois consonnes singulièrement placées, au répertoire chantant des concierges et des cuisinières. Quoi de plus gracieux et de plus poétique pourtant:
Si j'étais hirondelle! - Que je puisse voler, - Sur votre sein, la belle, - J'irais me reposer!
Il faut continuer, il est vrai, par: J'ai z'un coquin de frère.... ou risquer un hiatus terrible; mais pourquoi aussi la langue a-t-elle repoussé ce z si commode, si liant, si séduisant qui faisait tout le charme du langage de l'ancien Arlequin, et que la jeunesse dorée du Directoire a tenté en vain de faire passer dans le langage des salons?
Ce ne serait rien encore, et de légères corrections rendraient à notre poésie légère, si pauvre, si peu inspirée, ces charmantes et naïves productions de poètes modestes ; mais la rime, cette sévère rime française, comment s'arrangerait-elle du couplet suivant:
La fleur de l'olivier - Que vous avez aimé, - Charmante beauté ! - Et vos beaux yeux charmants, - Que mon coeur aime tant, - Les faudra-t-il quitter ?
(...)
La chanson que nous avons citée plus haut: Le roi Loys est sur son pont, a été composée sur un des plus beaux airs qui existent ; c'est comme un chant d'église croisé par un chant de guerre ; on n'a pas conservé la seconde partie de la ballade, dont pourtant nous connaissons vaguement le sujet. Le beau Lautrec, l'amant de cette noble fille, revient de la Palestine au moment où on la portait en terre. Il rencontre l'escorte sur le chemin de Saint-Denis. Sa colère met en fuite prêtres et archers, et le cercueil reste en son pouvoir. "Donnez-moi, dit-il à sa suite, donnez-moi mon couteau d'or fin, que je découse ce drap de lin!" Aussitôt délivrée de son linceul, la belle revient à la vie. Son amant l'enlève et l'emmène dans son château au fond des forêts. Vous croyez qu'ils vécurent heureux et que tout se termina là ; mais une fois plongé dans les douceurs de la vie conjugale, le beau Lautrec n'est plus qu'un mari vulgaire, il passe tout son temps à pêcher au bord de son lac, si bien qu'un jour sa fière épouse vient doucement derrière lui et le pousse résolument dans l'eau noire, en lui criant :
Va-t'en, vilain pêche-poissons, - Quand ils seront bons - Nous en mangerons.
Propos mystérieux, digne d'Arcabonne ou de Mélusine. - En expirant, le pauvre châtelain a la force de détacher ses clefs de sa ceinture et de les jeter à la fille du roi, en lui disant qu'elle est désormais maîtresse et souveraine, et qu'il se trouve heureux de mourir par sa volonté !... Il y a dans cette conclusion bizarre quelque chose qui frappe involontairement l'esprit, et qui laisse douter si le poète a voulu finir par un trait de satire, ou si cette belle morte que Lautrec a tirée du linceul n'était pas une sorte de vampire, comme les légendes nous en présentent souvent.
Du reste, les variantes et les interpolations sont fréquentes dans ces chansons ; chaque province possédait une version différente. (...) »
Gérard de Nerval, Œuvres complètes, tome III, coll. «Bibliothèque de la Pléiade,» 1993, pages 569-570 et 573-574.
Gérard de Nerval, Sylvie . - Souvenirs du Valois, publiée en 1853 dans le Revue des Deux Mondes avant d'être insérée dans Les Filles du Feu en 1854 :
II. - Adrienne
«Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l'esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les plus saillants d'une longue période de la vie.
Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d'ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d'ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d'un français si naturellement pur, que l'on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France.
J'étais le seul garçon dans cette ronde, où j'avais amené ma compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche, avec ses yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement hâlée!...Je n'aimais qu'elle, je ne voyais qu'elle, - jusque-là! A peine avais-je remarqué, dans la ronde où nous dansions, une blonde, grande et belle, qu'on appelait Adrienne. Tout d'un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s'empara de moi. - La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle, et aussitôt, d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d'amour, qui racontent toujours les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui la punit d'avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeules.
A mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. - Elle se tut, et personne n'osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. - Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers, plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressées en couronne et nouées d'un ruban. Je posai sur la tête d'Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures.
Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans le château. - C'était, nous dit-on, la petite-fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France; le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux; nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire.
Quand je revins près de Sylvie, je m'aperçus qu'elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d'en aller cueillir une autre, mais elle dit qu'elle n'y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents. Rappelé moi-même à Paris pour y reprendre mes études, j'emportai cette double image d'une amitié tendre tristement rompue, puis d'un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses que la philosophie de collège était impuissante à calmer.
La figure d'Adrienne resta seule triomphante, - mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l'année suivante, j'appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse.»
Gérard de Nerval, Œuvres complètes, tome III, coll. «Bibliothèque de la Pléiade,» 1993, pages 540-542.
Nerval, extrait des Odelettes, dans Petits châteaux de Bohême (1853), Nouvelle Librairie de France, 1959, p. 279 :
Fantaisie
«Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber ;
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C'est sous Louis treize... Et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,
Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens...
Que, dans une autre existence peut-être,
J'ai déjà vue ! - et dont je me souviens !»
Poème publié dans les Annales romantiques en 1835.
(La configuration de ce blogue ne me permet pas de restituer la composition strophique du poème)
LA FILLE DU ROI LOUIS
« De cette chanson non plus aucune version n’avait été publiée, que je sache, avant 1842. Nerval, ainsi qu’on l’a vu aux Variantes de notre texte, l’a fait figurer aussi dans les différentes rédactions du Voyage dans le Valois. Il semble bien qu’elle ait mis en jeu, dans la sensibilité de Nerval, des résonances particulièrement profondes. On sait le rôle que joue, dans l’histoire de Nerval, la figure, idéalement remémorée, d’Adrienne. Tandis que l’échec de son amour pour Jenny Colon, traversé par la disgrâce et par la mort, et son penchant à adorer une idée mystique de la femme, l’orientent vers la création de la fantastique Aurélia, à un autre pôle de son imagination surgit la figure d’une jeune fille entrevue au temps de son adolescence, inaccessible elle aussi, et laissée dans le passé, et morte, mais liée à des souvenirs réels du pays de son enfance. »
Paul Bénichou, Nerval et la chanson folklorique, José Corti, 1970, p. 258-259.
La suite, en cours, où ces documents (avec d'autres) seront convoqués lorsque nous travaillerons sur le romantisme, «mouvement» encore trop encombré - dans certains manuels - de clichés et de définitions aussi hâtives que sommaires...
En attendant, que la musique et la lecture vous inspirent les plus belles méditations !

