Il y a trop d’adjectifs dans L’Heure des Fous, de Nicolas Lebel, prêté par Sylvain. C’est la première impression que j’en ai eue, quasi chaque nom flanqué d’au moins un qualificatif, ça a un petit côté désuet, rédac’ d’autrefois… trop d’adjectifs, trop d’adverbes, trop de détails vestimentaires, couleurs des costumes et des cravates, du blouson ou de la jupe, trop de conversations parfois oiseuses qui affaiblissent des répliques enlevées ou bien senties, trop de JT restitués dans leur sommaire (avec pubs, ironiques peut-être, mais quand même !), il y a trop de comparaisons, parfois à la limite du ridicule : [l’homme] « tomba au sol comme une feuille qui, présomptueuse, a tenté de résister à l’automne », - Nooon ! -. En vérité et pour résumer, un trop grand souci de réalisme, un goût parfois excessif et naïf de la belle langue.
Mais cette avalanche de critiques n’est là qu’à titre d'exorde. Car, une fois ces réserves faites, parce qu’elles grippent la fluidité de ma lecture, L’heure des fous se lit d’une traite. L’intrigue mêle les flics d’un commissariat de quartier (le XIIe) avec la guerre des polices, une visite des égouts de Paris avec une bonne dose d’histoire - l’évocation de la cour des Miracles tressée avec celle des Catacombes - une réflexion sur les manipulations de masse avec l’évocation du monde contemporain des voyous, des clochards, des marginaux de tout poil…. Sous la houlette de l’insupportable, despotique, tonitruant capitaine Mehrlicht, incurable clopeur devant l’éternel, érudit, grossier, grand amateur d’argot et de sudokus, les flics Latour (Sophie, gracieuse et bretonne), Dossantos (Mickaël, bodybuildé tendance subfacho, mais brave type, en somme) et Ménard (François, Lyonnais, stagiaire) mènent tambour battant leur enquête sur le meurtre d’un clodo poignardé sur une voie de la gare de Lyon, laquelle les conduira d’un étrange monde de robins du Bois de Vincennes à un stock de chassepots disparus depuis le Second Empire, en passant par la Sorbonne, salles et cour d’honneur, ou la grande Arche de la Défense. De Victor Hugo (statue ET visite des égouts de Paris, avec flic portant autre flic blessé) à Eugène Sue (avec concierge Pipemot – celui des Mystères de Paris s’appelle Pipelet), en passant, et ce n’est pas l’un des moindres plaisirs ni l’une des moindres inventions de ce roman, par Michel Audiard et ses Tontons Flingueurs : le capitaine Mehrlicht est en effet doté d’un téléphone portable dont la sonnerie égrène, de façon aléatoire mais furieusement à propos in contextu, des répliques de ce film culte.C’est chez Marabooks (jamais entendu parler), et si je peux me permettre, la couverture, en cela très tendance, est parfaitement hideuse. Mais c’est un polar érudit, malicieux, et bigrement français. Pour un premier roman, c’est une belle réussite.
 Il y a
Il y a  Nous y avions déjeuné, il y a 28 ans, lors d’un bref
et épicurien séjour en Margeride, d’un généreux plat de girolles, de myrtilles
à peine cueillies, de fromage blanc à peine égoutté… il y avait une salle
basse, obscure, aux boiseries noircies par la fumée d’un âtre quasi médiéval
avec sa broche - et le chien d’alors, qui, gavé de restes succulents, snobait
les simples morceaux de pain.
Nous y avions déjeuné, il y a 28 ans, lors d’un bref
et épicurien séjour en Margeride, d’un généreux plat de girolles, de myrtilles
à peine cueillies, de fromage blanc à peine égoutté… il y avait une salle
basse, obscure, aux boiseries noircies par la fumée d’un âtre quasi médiéval
avec sa broche - et le chien d’alors, qui, gavé de restes succulents, snobait
les simples morceaux de pain. 


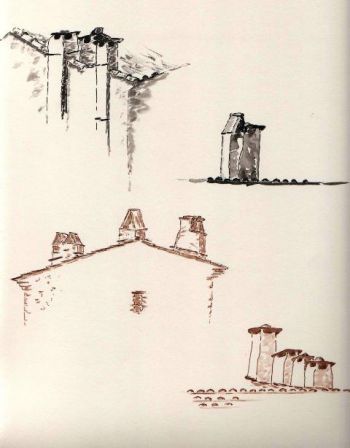






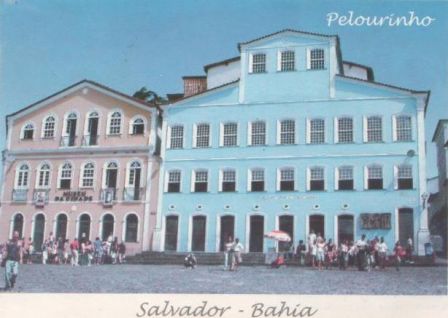

 L’un naissait au moment où
l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,
« illuminée ».
L’un naissait au moment où
l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,
« illuminée ».





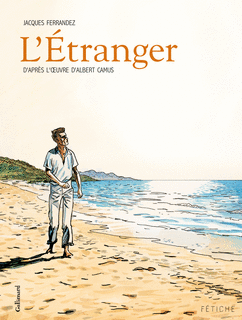 L’Étranger de Camus dans la version graphique de
L’Étranger de Camus dans la version graphique de